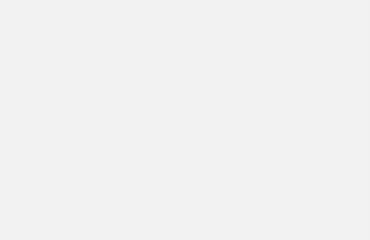13 et 14 Octobre 2025 – Maison de la Recherche de Nancy
Appel à communication
Cet appel met en tension les notions de savoirs, de genre et de santé. La première est entendue dans son acception large : elle renvoie à la fois à des savoirs formalisés, mais aussi des techniques (Fidolini, Voléry, 2022), des narrations et des scripts (Martins, 1991 ; Gagnon, Simon, 2005 ; Sobocinska, 2023) ou encore des régimes de catégorisation (Beaucourt, Laiacona et Mégret, 2024). Peu importent les producteurs, la légitimité ou les modes de circulation de ces savoirs (savoirs académiques, expérientiels, profanes, militants, etc). Le savoir est entendu ici comme indissociable du pouvoir (Foucault, 1993[1975]). Il s’agit donc d’interroger la manière dont les savoirs peuvent se constituer en instruments de pouvoir, dès lors qu’ils sont retenus ou mis en mouvement. Ensuite, le genre est pensé comme une construction sociale, en ce qu’il repose sur des savoirs dont on peut retracer l’origine (Laqueur, 1992). Mais le genre est aussi pensé comme un rapport social, un système de domination qui oriente la circulation et la construction des savoirs (Dorlin, 2009). Enfin, dans cet appel la santé peut être saisie à travers la notion de médicalisation, c’est-à-dire la tendance à « définir un problème en des termes médicaux, en général comme une maladie ou un trouble, ou à défendre une intervention médicale pour le traiter ». (Conrad, 2005, p. 3).
L’actualité du concept témoigne d’un renouvellement constant du biopouvoir qui semble prendre appui sur de nouveaux savoirs et de nouvelles techniques contribuant au passage à façonner les rapports de genre (Fassin, Memmi, 2004 ; Gelly, Pitti, 2016 ; Jarty, Fournier, 2020 ; Bouchet-Mayer et al., 2022). Toutefois, à rebours d’un biopouvoir totalisant, uniforme et descendant, cet appel entend aussi analyser les formes situées d’appropriation et/ou de résistance aux normes de santé depuis le bas, jusque dans des pratiques de soin ou d’entretien de soi (Bichet, 2020 ; Diasio, Fidolini, 2019). Si le genre est parfois produit par la médecine, les conceptions genrées du corps ont bien-sûr prise hors des seuls espaces
médicaux (Chaperon, Hanafi, 2013).
Les propositions de communication pourront s’inscrire dans un ou plusieurs des axes détaillés ci-après. Elles devront travailler à articuler ces réflexions théoriques à un matériau empirique original et contextualisé. Au-delà des enjeux présentés jusqu’ici, nous serons particulièrement attentif·ves aux propositions de communication qui adoptent une perspective articulant les rapports sociaux de race, de classe et d’âge (entre autres) au genre.
1/ Des savoirs sur le corps et la santé pris dans les rapports de pouvoir liés au genre
Penser le mouvement des savoirs implique aussi de penser les conditions de construction et de légitimation des savoirs, dans la continuité des travaux féministes critiques de la neutralité des savoirs positivistes (Haraway, 1988). En réalité, les lacunes dans la connaissance de certains corps, les partis pris normatifs dans la description de certains autres, ou encore les savoirs manquants, sont des sources de réflexion en ce qu’ils révèlent des rapports de genre. C’est ce que montrent les travaux de Nelly Oudshoorn (2003) sur la (non)commercialisation de la contraception masculine, ou plus récemment ceux de Camille Bajeux (2020) sur le développement controversé de l’andrologie. Ces travaux interrogent, en
sus, l’androcentrisme des sciences « dures », la survalorisation de certaines expertises (Coureau, et. al., 2022) et la mise en concurrence de savoirs disciplinaires (certaines approches psychologisantes, hormonales, etc.). Par ailleurs, les travaux de Shannon Sullivan et Nancy Tuana (2007) à propos de l’ignorance blanche (white ignorance) interrogent les raisons de l’inexistence de certains savoirs derrière le concept « d’épistémologie de l’ignorance » : l’ignorance n’est pas qu’une absence de savoir que l’on peut chercher à combler, mais bien un processus actif et un outil de pouvoir. Blas Radi (2022) applique
cette grille de lecture au cissexisme, en montrant son déploiement quotidien, prenant pour exemple les politiques de santé en Argentine. Il interroge un « droit d’ignorer » la situation des personnes trans’ qui reproduit des écarts entre la législation et les pratiques effectives.
Comment des rapports de pouvoir découlant ou non du genre produisent-ils une silenciation de certains savoirs ? Comment certains savoirs sont-ils rendus plus ou moins légitimes, en raison de leur ancrage disciplinaire, mais aussi de l’aire culturelle de laquelle ils émanent ? Comment les conditions de production des savoirs influencent-elles la manière dont nous interprétons, produisons et agissons sur les corps ?
La réflexion encouragée dans ce premier axe peut aussi se déployer par le bas en interrogeant les appropriations situées de ces savoirs sur le corps, ainsi que les formes de résistances qu’ils entrainent. Certains savoirs ont continué par exemple de circuler dans des cercles homosociaux féminins malgré la médicalisation des pratiques de soin, à l’instar de certains savoirs profanes (Verdier, 1979). De manière plus contemporaine, les mobilisations féminines et/ou féministes pour l’autonomie dans la santé sexuelle et reproductive continuent de faire l’objet de recherche, comme dans le cadre de la mobilisation du Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception (Ruault, 2017) ou de la pratique militante du self help (Quéré, 2021). Comment les acteur·ices, à partir de leur position sociale, font-iels preuve « d’inventivité profane » (Ruault, op. cit.) ? Quels savoirs sur leur corps produisent-iels et quels
rapports de pouvoirs parviennent-iels ainsi à négocier ? Par ailleurs, les savoirs détenus par les usagers des dispositifs de santé tendent à acquérir une place nouvelle y compris dans les espaces médicaux et dans les parcours de soin du fait d’une injonction à « l’autonomisation du patient ». C’est ce dont témoignent les figures récentes du « patient expert », du « patient partenaire » ou du « pair aidant » dans le cas des maladies chroniques, souvent inscrites dans des programmes plus larges d’éducation du patient (Ménoret, 2023). La distance prescrite vis-à-vis d’une posture médicale paternaliste se traduit aussi dans le rapport de force qui peut s’instaurer entre associations d’usagers et médecins, illustré dans le cas de la (dé)médicalisation des parcours trans’. Ces travaux témoignent de nouveaux modes d’exercice du pouvoir médical, et interrogent parfois la manière dont ces derniers révèlent ou modifient d’autres rapports de pouvoir, comme les rapports de genre (Beaubatie, 2016) : la place faite aux savoirs expérientiels et profanes est-elle la même selon le sexe, la sexualité et l’identité de genre de l’usager·ère ? Comment sont traités, légitimés ou instrumentalisés les savoirs issus de certaines expériences genrées minoritaires ?
Enfin, sont également attendus dans cet axe des travaux interrogeant la fabrication de savoirs en sciences sociales, et la manière dont nos dispositifs de recherche mettent en mouvement des savoirs existants. Dans le prolongement des réflexions proposées ci-dessus, les communiquant·es sont invité·es à questionner leurs conditions matérielles de travail (d’accès au terrain, d’enquête et d’analyse), ainsi que leur position sociale (de genre, de race, de classe, d’âge, etc.) et les effets qu’elles ont sur leur manière d’appréhender l’enquête. Ces réflexions pourront servir à discuter la notion d’objectivité forte (Harding,
1993), qui postule qu’une expérience de la domination étudiée peut créer les conditions d’une analyse plus juste. Elles pourront aussi interroger les avantages et les limites de la recherche participative, ou d’autres méthodes d’enquête qui visent à réduire les injustices épistémiques (Fricker, 2007), et penser conjointement production de connaissance et inégalités sociales. Les communiquant·es sont invité·es également à interroger la manière dont leur présence et les processus de catégorisations dont iels font l’objet (Greco, 2010) ont pu entrainer des formes de rétention ou de mise en circulation de savoirs exploitables dans l’enquête. Par exemple, la littérature témoigne d’un privilège féminin pour interroger l’intimité corporelle (Schlagdenhauffen, 2014), pouvant en revanche s’encombrer d’un rapport de séduction dans la relation d’enquête (Clair, 2016). Plus spécifiquement, les propositions de communication pourront interroger les bénéfices et les désagréments de la mise en circulation des savoirs par les chercheurs sur les individus qui peuplent le terrain, comme dans les travaux sur les sociabilités homosexuelles qui courent le risque de trahir des lieux de séduction tenus secrets dans l’Amérique des années 1960 (Humphreys, 2007).
2/ Circulation subjective et intersubjective de la normativité corporelle et médicale
Ce second axe met l’accent sur les formes de subjectivités produites par la reconfiguration des savoirs-pouvoirs dans le champ de la santé. La biomédicalisation se traduit en effet par une emprise du prisme médical sur les corps mais aussi sur les rapports subjectifs au corps par une intensification des mécanismes d’intériorisation du pouvoir (Clarke et al., 2000, Braverman, 2017). Ce dernier n’est ainsi pas toujours imposé de l’extérieur, comme le relevait déjà Michel Foucault dans son usage du concept de subjectivation : la subjectivité se construit et se transforme continuellement, au gré des identifications, et toujours dans un rapport d’assujettissement à un pouvoir (Julien, 2015). Récemment, les travaux qui ont cherché à appliquer les théorisations de Connell sur les modèles de masculinité (Connell, 2014) aux terrains en santé, témoignent particulièrement bien de ces processus de subjectivation. Par exemple, Louis Braverman analyse l’examen de la prostate comme une mise à l’épreuve des masculinités et relève qu’il n’est pas vécu comme aussi menaçant pour les identifications masculines chez les patients les plus âgés : l’âge avancé et les catégorisations médicales de cet âge viennent les préserver (Braverman, 2019). Autre exemple : les travaux sur la reconfiguration des pratiques alimentaires des hommes au milieu de la vie, témoignent du fait que les stratégies visant à préserver sa santé sont pensées en négociation avec des représentations situées des « bonnes » pratiques de santé et des styles de masculinité de classe (Diasio, Fidolini, 2019). En quoi et dans quelle mesure la normativité médicale s’immisce-t-elle dans les subjectivités ? Comment la position sociale de genre (y compris dans la hiérarchie des styles de genre) intervient-elle dans ce processus ? Quelles négociations subjectives relatives au genre les savoirs en santé donnent-ils à lire ? Les savoirs en santé témoignent parfois du déploiement de ces négociations à des échelles intersubjectives. C’est de cette façon que l’on peut lire les travaux sur les biosocialités contemporaines, c’est-à-dire les sociabilités fondées sur des expériences corporelles pensées comme communes à un groupe social (Rose & Rabinow, 2006). On peut citer ici la recherche d’Alexandra Afsary sur les pratiques de la « contraception naturelle ». Elle révèle que la légitimité attribuée aux savoirs médicaux peut être affaiblie à la faveur d’un processus de socialisation à des lectures « post-féministes » (Afsary, 2021). Dans son travail, Cécile Charlap montre quant à elle de quelle manière les femmes articulent les lectures profanes de la ménopause auxquelles elles ont été socialisées par les femmes de leur lignage et les lectures médicales diffusées plus largement (Charlap, 2014). Enfin, les travaux qui portent sur la santé communautaire témoignent du développement d’expertises médicales hors des espaces médicaux grâce à des pratiques de mise en commun des savoirs, des parcours informationnels très poussés, ou encore l’enrôlement de professionnels de santé (Armangau, Figeac, 2023 ; Stassin, 2023). Des savoirs de nature différente ou produits depuis des positions opposées s’hybrident-ils ou restent-ils en concurrence ? De quelle façon se construit la légitimité d’un savoir de santé qui touche au corps genré ? Quels sont les effets sur le plan subjectif de ces socialisations complexes ?
Il ne s’agit pas d’interroger ces enjeux en négligeant ce que la position sociale de classe produit en termes de possibilités et de stratégies de négociation de la normativité médicale et de genre. D’abord, les styles de genre (masculinité ou féminité) envisagés ici à l’aune d’un processus de subjectivation des savoirs en santé ou sur le corps, sont toujours situés. C’est ce dont témoignent les travaux d’Aurélia Mardon sur les pratiques vestimentaires des jeunes filles de classe populaire, perçues à l’aune d’une hypersexualisation par les mères de classe moyenne (Mardon, 2011), ou les travaux d’Arthur Vuattoux sur les jeunes qui font face aux institutions judiciaires et dont le style de genre, plus ou moins qualifiant, intervient dans les jugements (Vuattoux, 2021), ou encore ceux de Mara Viveros Vigoya (2018) qui pense des styles de masculinités racialisés. Par ailleurs, la relation entre médecins et patients donne aussi à lire des rapports de classe dans les formes de rétention ou de mise en circulation de l’information (Fainzang, 2006) et dans les jugements exercés par les médecins sur la « valeur sociale des patients » (Paillet, 2021). Et dans le même temps, la négociation des savoirs en santé légitimes ou possédés par les médecins est traversée par des stratégies de distinction comme le montrent les travaux sur la « bonne volonté sanitaire » des classes populaires (Arborio, Lechien, 2019). Enfin, si la classe façonne les rapports aux normes de genre, cela se fait dans un contexte plus général de « conscientisation » de ces normes du fait de la diffusion des savoirs féministes (Blum et Santelli, 2023), dont on peut interroger les appropriations situées. De quelle façon et à quels niveaux la position sociale de classe médiatise-t-elle l’intériorisation, la négociation et l’hybridation des savoirs sur le corps et la santé ? Quid des positions de genre situées par la classe dans le processus de subjectivation des savoirs médicaux ?
3/ Les supports matériels et relationnels des savoirs sur le corps et leurs effets sur les rapports de genre
La circulation des savoirs peut être interrogée à travers ses supports. D’abord il faut relever que les savoirs en question sont parfois des savoirs pratiques liés au genre, que l’on peut envisager comme des techniques. Certaines techniques liées à la sexualité font l’objet d’un traitement normatif variable selon les contextes sociohistoriques et questionnent ainsi les enjeux de cet appel. Par exemple, si les pratiques onanistes masculines ont pu être considérées comme sources de nombreux « maux » par la médecine, tels que l’infertilité ou la féminisation (Bajeux, 2022), elles engendrent aujourd’hui de nouvelles subjectivités et sont réappropriées par exemple par le mouvement NO FAP. Ce dernier, investi entre autres par des masculinistes, prône l’arrêt de la masturbation pour protéger la virilité en augmentant le taux de testostérone (Gourrarier, Voros, Wallin, 2023). Comment les techniques incluant le corps trouvent-elles dans un contexte donné une signification sociale spécifique (Bozon, 1999) ? Comment ces techniques, envisagées comme des savoirs pratiques, circulent-elles ? Mais les techniques sont parfois des outils de mise en circulation des savoirs, outils pris dans les mutations des sociétés contemporaines (Rosa, 2012). Les travaux portant sur l’usage des NTIC dans des parcours informationnels (Afsary, 2021 ; Stassin, 2023) témoignent d’un accès facilité aux savoirs. D’autres travaux, consacrés par exemple au développement des communautés masculinistes en ligne (Gourarier, 2017), montrent comment les NTIC peuvent participer d’un mode de régulation et de production du genre, en l’occurrence des masculinités.
L’accès facilité aux savoirs oriente aussi les modes d’appropriation et de négociation des savoirs « psy » ou médicaux, jusqu’à la maitrise de gestes techniques, dans le cas de l’usage des hormones injectables sans ordonnance par les femmes trans’ (Raia, 2022). Comment les NTIC transforment-elles la diffusion des savoirs liés au corps et à la santé ? Comment contribuent-elles à faire évoluer la hiérarchie des savoirs ? De quelle manière impactent-elles les rapports de genre ?
Ensuite, lorsqu’ils sont saisis par la santé publique, il apparait que les savoirs peuvent être inscrits dans des dispositifs, c’est-à-dire dans des ensembles hétérogènes d’éléments – discursifs, institutionnels, techniques, spatiaux – qui instituent des rapports de pouvoir (Foucault, 1977). Les travaux de Dominique Memmi (2003) et plus récemment ceux d’Aurore Koechlin (2022) témoignent de la force des dispositifs de santé pour faire circuler les savoirs, au point qu’il peut y avoir un brouillage entre savoirs experts et savoirs profanes. Ils témoignent aussi d’un mode de gouvernement des conduites par la parole qui possède des ramifications jusque dans des politiques et institutions périphériques à la santé comme celles de l’accompagnement socio-éducatif (Teillet, 2022). En prolongement de ces approches parfois décrites comme « aveugles au genre » (Mainsant, 2016), quelles conceptions du genre soutiennent ou traversent les dispositifs de santé publique ? Comment ces dispositifs participent-ils à faire se rencontrer et s’hybrider différents savoirs ? D’autres travaux se sont penchés sur les appropriations situées des savoirs diffusés dans les dispositifs de santé, notamment lorsque ces savoirs prennent la forme de techniques, et de leurs effets sur les rapports de genre. Cécile Thomé relève que le préservatif, une technique contraceptive pensée pour les hommes, peut finalement être davantage investie par les
femmes et contribuer à alourdir leur charge contraceptive (Thomé, 2016). Des intérêts de recherche similaires nourrissent une littérature sur les techniques à la marge de ces dispositifs en raison de leur illégitimité médicale ou de leur faible technicité perçue : la technique du retrait dans l’hétérosexualité façonne également les rapports de genre en conférant aux hommes plus de pouvoir dans la gestion du rapport sexuel et du rythme contraceptif (Fidolini, Voléry, 2022). Quels savoirs pratiques sont construits en marge des dispositifs de santé ? Quelle place leur est faite dans ces dispositifs ? Quelles formes de reproduction ou de subversion des rapports de genre sous-tendent-ils ?
Enfin, les propositions peuvent saisir les espaces comme des supports qui permettent aux savoirs de circuler. Ils le sont d’abord dans la tradition théorique qui saisit la classe à travers les espaces locaux (Renahy, 2010 ; Giraud, 2016) : l’appartenance à un territoire donne accès à certains réseaux à l’intérieur desquels peuvent circuler des savoirs. Ils le sont également à la plus petite échelle des scènes d’interaction. Par exemple, à l’école ou au centre de loisirs, les interactions entre adultes et enfants permettent une (re)production et une circulation de dispositions sexuellement et socialement différenciées à aimer (Ditier, 2015). A distance des institutions, c’est dans les squats que Sarah Nicaise saisit les socialisations secondaires militantes « transpédégouine » à la sexualité, rendues possibles par la constitution ou la réévaluation de certains savoirs (Nicaise, 2023). Les cercles homosociaux et la sphère conjugale semblent être, eux aussi, particulièrement propices à la transmission de savoirs impliquant le corps et la santé traversés par des rapports de genre : c’est ce dont témoignent des travaux en cours sur la circulation des savoirs en santé sexuelle et reproductive (Rzeszotko-Rutili, 2024), ainsi que les travaux sur les classes populaires rurales plus largement (Coquard, 2018 ; Amsellem-Mainguy, 2023). Quels savoirs corporels émergent et circulent dans les espaces locaux ? Et dans l’intimité amicale et conjugale ?
Comment ces savoirs influencent-ils les relations et modifient-ils les pratiques ? Ces réflexions invitent par ricochet à interroger la forme que prennent les savoirs : écrits, transmissions orales, incorporation inconsciente, etc. Elles peuvent aussi nous inviter à questionner nos méthodes d’enquête : analyses d’archives, analyse de documents numériques, télévisuels, utilisation du dessin en entretien (le body mapping, par exemple), etc. De quelles techniques dispose-t-on, par exemple, pour enquêter les savoirs ordinaires, informels, routinisés sur le corps et la santé ? Quelles sont les limites de ces techniques ?
4/ Les savoirs sur le corps, le genre et la santé au prisme des temporalités
Dans ce dernier axe, sont attendues des recherches s’intéressant à la place des temporalités dans les dispositifs de gouvernement du corps et du genre et aux façons dont ces dispositifs élaborent de nouvelles scansions temporelles (Julien, 2014 ; Diasio, Vinel, 2017 ; Voléry, Balard, 2021). Cette littérature montre que les savoirs sur le corps et la santé sont particulièrement mobilisés aux seuils du parcours biographique (puberté, ménopause, grossesse, mort, naissance, etc.). Les transitions d’âge constituent souvent des moments d’instabilité des positions sociales et des identifications, autrement dit elles peuvent entrainer d’autres déplacements, y compris dans l’ordre du genre (sur ce point, voir aussi
Mardon, 2011 ; Braverman, 2019) ; elles sont en conséquence des moments qui font l’objet d’un encadrement social très resserré auquel participent les savoirs. Certains savoirs viennent borner, à l’instar des techniques déployées par les pompiers dans le cas des morts « traumatiques » (Fornezzo, 2021). D’autres dictent le rythme : les travaux sur la fin de vie montrent comment certains savoirs professionnels façonnent les temps quotidiens dans le travail palliatif au grand âge (Voléry, Schrecker, 2018). D’autres encore permettent d’apporter du sens lorsque la transition est imprévue, comme dans une thèse en cours qui interroge le travail familial autour de jeunes trans’ (Boulet, 2022). Quels sont les registres de mobilisation des savoirs dans les transitions qui touchent au genre, y compris celles qui ont un caractère atypique, accidentel ou exceptionnel ? A quelles fins les savoirs sont-ils utilisés dans le cadre de ces transitions ?
Par ailleurs, les savoirs sur le corps et la santé participent à la fabrication et à la reproduction d’âges genrés. On peut penser ici aux travaux portant sur les pratiques de mesure de la puberté par les médecins (Piccand, 2015) qui témoignent d’une reproduction des normes genrées d’avancée en âge à la faveur des savoirs et des techniques médicales. D’autres travaux mettent plutôt l’accent sur les expériences de la santé au grand âge selon le sexe et les savoirs qui les façonnent. Par exemple, les conceptions ordinaires de la santé féminine, notamment au grand âge ont des conséquences sur le recours au soin : la santé
gynécologique étant rabattue sur la maternité et la capacité procréative, les femmes âgées consultent moins (Membrado, 2006). Du côté des hommes âgés, une enquête exploratoire confirme notamment le poids identitaire du travail, omniprésent dans les récits de soi. Cela les conduit à mobiliser après le passage à la retraite des lectures en termes de « deuil » ou de « culpabilité », et à s’investir dans d’autres activités, répondant au passage à l’injonction de « bien vieillir », c’est-à-dire de rester actif (Charpentier, Quiénart, 2019). Comment les savoirs liés aux âges construisent-ils des frontières de genre ? Sont-ils intériorisés ou négociés par les personnes qu’ils visent, ou celles qui les mobilisent ?
Enfin, la circulation des savoirs en santé est impactée par les temporalités en ce qu’elle implique parfois des transmissions intergénérationnelles. Les travaux qui ont mis la focale sur la socialisation de l’intimité corporelle à l’adolescence sont de ceux qui révèlent une abondance de transmissions dans les lignées sexuées (Mardon, 2009 ; Diasio, Vinel, 2015), de manière complémentaire aux travaux sur les socialisations familiales au sport (Mennesson, 2011). Certains travaux sur les parents de jeunes LGBT+ montrent même de quelle façon ces transmissions participent de la négociation de rapports d’âge (Masclet, 2023).
On peut penser aussi aux recherches sur les socialisations impliquant les grands-parents, plus à distance des enjeux de santé. Ces socialisations, dans lesquelles les grands-mères semblent plus engagées, sont particulièrement souples et électives du fait de la place secondaire qui leur est faite par les parents (Le Borgne-Ugen, 2003). Au-delà des transmissions directes, il ne faut pas négliger que chaque génération peut se faire le relai de savoirs transmis par la génération précédente, et que les savoirs des ainés circulent à une multitude de niveaux et dans une multitude de sens (Chanez et al., 2009). Certains travaux
qui saisissent d’autres espaces que l’espace familial témoignent aussi de formes d’étanchéité entre savoirs générationnels : dans certains espaces féministes les approches queer associées à la jeune génération ont semblé concurrencer et succéder aux approches matérialistes, mais une analyse plus fine révèle des formes situées de socialisations ascendantes et d’hybridation (Fourment, 2017). Comment la génération façonne-elle la circulation des savoirs ? Dans quelle mesure ces savoirs peuvent-ils circuler entre les lignées sexuées ? Comment la génération peut-elle générer une distance sociale qui freine ces transmissions ?
Informations pratiques
L’évènement se tiendra à Nancy les 13 et 14 octobre 2025 à la Maison de la Recherche, 23/25 rue Baron Louis. Il sera suivi d’un nouvel appel en vue d’une publication (numéro de revue ou ouvrage collectif) destinée à valoriser les échanges qui s’y seront tenus.
Ce colloque est organisé à l’initiative des doctorant·es du laboratoire TETRAS (Sociologie des Territoires, du Travail, des Âges et de la Santé). Avec une prévalence du regard sociologique, il entend prolonger des réflexions esquissées lors du séminaire itinérant du RJCSS (Réseau Jeunes Chercheur·euses Santé et Société) et encourager la décentralisation des échanges scientifiques chère au réseau. Il s’adresse aux jeunes chercheur·euses ainsi qu’aux chercheur·euses titulaires en sciences sociales (notamment sociologie, anthropologie, histoire et philosophie) désireux·ses d’interroger leurs terrains à partir des questions développées dans cet appel.
Porté par le laboratoire TETRAS, ce colloque alimente des échanges entre les laboratoires du pôle CLCS, à travers l’inclusion dans le Comité Scientifique de chercheur·euses des Archives Henri Poincaré (UMR, Philosophie et Histoire) et du CREM (UMR, Sciences du Langage et Sciences de l’Information et de la Communication). A l’échelle locale, cette initiative est soutenue par le pôle SJPEG, qui met à disposition certains de ses locaux. A l’échelle nationale, elle est soutenue par le GIS (Groupement d’Intérêt Scientifique) Institut du Genre, l’AFS (Association Française de Sociologie) et le RJCSS. Enfin, l’événement est soutenu par certains acteurs locaux en santé à l’instar de Promotion Santé Grand-Est.
Modalités de soumission des propositions
Les propositions de communication prendront la forme d’un résumé de 3000 à 4000 signes (espaces compris) maximum, hors bibliographie. Elles sont à envoyer à l’adresse suivante : savoirsgenresante@gmail.com avant le 28 avril 2025. Merci d’y faire figurer le titre de la communication, l’axe ou les axes dans lesquels elle pourrait s’inscrire, ainsi que votre nom, prénom, statut, rattachement institutionnel et adresse e-mail.
Les communiquant·es retenu·es s’engagent à produire un plan détaillé ou un script de la communication destiné à faciliter le travail des animateur·ices des sessions. Ce document ne devra pas excéder 40 000 signes (espaces compris) hors bibliographie et devra nous parvenir au plus tard le 14 septembre 2025.
Il ne sera pas possible de communiquer ni de figurer dans le programme sans s’être inscrit·e et sans s’être acquitté·e des frais d’inscription fixés à 60€ HT (soit 66€ TTC) pour les personnes titulaires (enseignant·e·s-chercheur·e·s, chercheur·e·s, autres salarié·e·s titulaires, etc.) et à 30€ HT (soit 33€ TTC) pour les personnes non titulaires (doctorant·e·s, ATER, vacataires, chômeurs et chômeuses, etc.). Ces frais couvriront une partie des dépenses liées à l’organisation du colloque, dont les frais de restauration des repas de midi.
Calendrier
Limite de dépôt des résumés : 28 avril 2025
Réponse du Comité Scientifique : 26 mai 2025
Limite de règlement des frais d’inscription : 14 septembre 2025
Limite d’envoi des communications : 14 septembre 2025
Colloque scientifique : 13 et 14 octobre 2025
Comité d’organisation
Boulet Arthur (Doctorant en Sociologie, TETRAS)
Rutili-Rzeszotko Marylou (Doctorante en Sociologie, TETRAS)
Barroyer Marie (Doctorante en Sociologie, TETRAS)
Bermaky Salma (Doctorante en Sociologie, TETRAS)
Laurain Chrystelle (Gestionnaire administrative et financière, TETRAS)
Vathelet Virginie (Chargée de valorisation de la recherche, TETRAS)
Comité scientifique
Balard Frédéric (MCF en Sociologie, TETRAS)
Bois Géraldine (MCF en Sociologie, TETRAS)
Braverman Louis (MCF en Sociologie, LABERS)
Crignon Claire (PU en Philosophie, AHP)
Diasio Nicoletta (PU en Sociologie et Anthropologie, LinCS)
Fidolini Vulca (MCF en Sociologie, TETRAS)
Greco Luca (PU en Sciences du Langage, CREM)
Hanafi Nahema (MCF en Histoire,TEMOS)
Julien Marie-Pierre (MCF en Anthropologie, TETRAS)
Koechlin Aurore (MCF en Sociologie, CETCOPRA)
Mainsant Gwenaelle (Chargée de recherche CNRS, IRISSO)
Mardon Aurelia (MCF HDR en Sociologie, CLERSÉ)
Nicaise Sarah (docteure en Sociologie, CRESCO)
Paillet Anne (PU en Sociologie, CESSP)
Ruault Lucile (Chargée de recherche CNRS, CERMES3)
Schlagdenhauffen Régis (MCF HDR en Sociologie, IRIS)
Stassin Berangère (MCF en SIC, CREM)
Tcholakova Albena (MCF en Sociologie, TETRAS)
Thomé Cécile (Chargée de recherche CNRS, CMH)
Vinel Virginie (PU en Sociologie et Anthropologie, LASA)
Voléry Ingrid (PU en Sociologie, TETRAS)
Vuattoux Arthur (MCF en Sociologie, IRIS)
Bibliographie
Afsary, A. (2021). De la contraception hormonale à la contraception « naturelle » : postféminisme et transformation du rapport à soi. In I. Voléry & F. Balard (Eds.), La médicalisation des âges en France (pp. 25-43). Presses Universitaires de Nancy.
Amsellem-Mainguy, Y. (2023). Les filles du coin. Presses de Sciences Po.
Arborio, A., & Lechien, M. (2019). La bonne volonté sanitaire des classes populaires : Les ménages employés et ouvriers stables face aux médecins et aux normes de santé. Sociologie, 10(1), 91-110. https://shs.cairn.info/revue-sociologie-2019-1-page-91?lang=fr
Armangau, Y., & Figeac, J. (2023). Les formes de la solidarité sociale dans les groupes Facebook trans. Réseaux, 242(6), 205-238. https://doi.org/10.3917/res.242.0205
Bajeux, C. (2022). Quelle andrologie ? Histoire des savoirs et des pratiques médicales du masculin en France et Suisse romande (années 1890-1970) [Thèse de doctorat, Université de Genève].
Beaubatie, E. (2016). Psychiatres normatifs vs. trans’ subversifs ? Controverse autour des parcours de changement de sexe. Raisons politiques, 62(2), 131-142. https://doi.org/10.3917/rai.062.0131
Beaucourt M., Laiacona, E., & Mégret, E. (2024). Corps et techniques : du visible à l’invisible. Revue des sciences sociales. https://journals.openedition.org/teth/4856
Bichet, L. (2020). La place des dispositifs médicaux dans le réagencement des relations familiales et la constitution d’une communauté de pratique. Revue internationale de l’éducation familiale, 48(2), 47-64. https://doi.org/10.3917/rief.048.0047
Blum, B., & Santelli, E. (2023). Questionner l’influence des idées féministes sur la sexualité masculine hétérosexuelle : vers l’émergence d’un nouveau modèle de masculinité ? Nouvelles Questions Féministes, 42(2), 64-81.
Bouchet-Mayer et al. (2022). Ethnographier le gouvernement des corps et des conduites. Revue Terrains/Théories. https://journals.openedition.org/teth/4856
Boulet, A. (2022). Les narrations autour des « transitions de genre » à l’adolescence. Balisages, 5. https://doi.org/10.35562/balisages.957
Bozon, M. (1999). Les significations sociales des actes sexuels. Actes de la recherche en sciences sociales, 128(3), 3-23. https://doi.org/10.3917/arss.p1999.128n1.0003
Braverman, L. (2017). Masculinités vieillissantes à l’épreuve du cancer de la prostate [Thèse de doctorat, EHESS]
Braverman, L. (2019). La sexualité des hommes après un cancer de la prostate : âge, genre et pouvoir. Sciences sociales et santé, 37(3), 5-30. https://doi.org/10.1684/sss.2019.0146
Chanez, A., Quéniart, A., & Charpentier, M. (2009). La transmission des valeurs d’engagement des aînées militantes à leurs descendants : une étude de cas de deux lignées familiales. In A. Quéniart & R. Hurtubise (Eds.), L’intergénérationnel : Regards pluridisciplinaires (pp.195-216). Presses de l’EHESP.
Chaperon, S., & Hanafi, N. (2013). Médecine et sexualité, aperçus sur une rencontre historiographique (Recherches francophones, époques moderne et contemporaine). Clio. Femmes, Genre, Histoire, 37, 123-142. https://doi.org/10.4000/clio.11030
Charlap, C. (2014). Comment on devient ménopausé : de la ménopause sociale à la ménopause physiologique, un parcours d’apprentissage. Corps, 12(1), 221-229. https://doi.org/10.3917/corp1.012.0221
Charpentier, M., Quéniart, A., & Glendenning, J. (2019). Vieillir au masculin : Entre déprise et emprise des normes de genre. In A. Meidani & S. Cavalli (Eds.), Figures du vieillir et formes de déprise (pp. 305-325). Érès. https://doi.org/10.3917/eres.meida.2019.01.0305
Clair, I. (2016). La sexualité dans la relation d’enquête : Décryptage d’un tabou méthodologique. Revue française de sociologie, 57(1), 45-70. https://doi.org/10.3917/eslm.156.0067
Clarke, A., Fishman, J., Fosket, J. R., Mamo, L., & Shim, J. (2000). Technosciences et nouvelle biomédicalisation : racines occidentales, rhizomes mondiaux. Sciences Sociales et Santé, 18(2), 11-42.
Connell, R. W. (2014). Masculinities : enjeux sociaux de l’hégémonie. Éditions Amsterdam.
Conrad, P. (2005). The shifting engines of medicalization. Journal of Health and Social Behavior, 46(1), 3-14. https://doi.org/10.1177/002214650504600102
Coquard, B. (2018). Faire partie de la bande : Le groupe d’amis comme instance de légitimation d’une masculinité populaire et rurale. Genèses, 111(2), 50-https://doi.org/10.3917/gen.111.0050
Coureau, T., Jarty, J., & Lapeyre, N. (2022). Le genre des sciences. Approches épistémologiques et pluridisciplinaires. Lormont : Le bord de l’eau.
Diasio, N., & Fidolini, V. (2019). Garder le cap. Corps, masculinité et pratiques alimentaires à « l’âge critique ». Ethnologie Française, 49(4), 751-767. https://doi.org/10.3917/ethn.194.0751
Diasio, N., & Vinel, V. (2015). La salle de bain : Reconfiguration des rapports aux autres et à soi à l’aube de l’adolescence. La revue internationale de familiale, 37(1). https://doi.org/10.3917/rief.037.0039
Diasio, N., & Vinel, V. (2017). Corps et préadolescence. Presses Universitaires de Rennes.
Diter, K. (2015). « Je l’aime, un peu, beaucoup, à la folie… pas du tout ! » La socialisation des garçons aux sentiments amoureux. Terrains & travaux, N° 27(2), 21-40. https://doi.org/10.3917/tt.027.0021.
Dorlin, E. (2009). La matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la Nation française. La Découverte. Fainzang, S. (2006). La relation médecins-malades : informations et mensonges. Presses
Universitaires de France.
Fassin, D., & Memmi, D. (2004). Le gouvernement des corps. Éditions de l’EHESS.
Fidolini, V., & Voléry, I. (2022). Le retrait : entre technique contraceptive et espace de recomposition des masculinités. Sciences sociales et santé, 40(3), 99-107.https://doi.org/10.1684/sss.2022.0234
Fornezzo, É. (2021). Les morts « traumatiques » selon la sociologie et leur catégorisation par les pompiers et professionnels du funéraire. Études sur la mort, 156(2), 67-https://doi.org/10.3917/eslm.156.0067
Foucault, M. (1993). Surveiller et punir [1ère éd. 1975]. Paris : Gallimard.
Foucault, M. (1994). Le jeu de Michel Foucault (1977). In Dits et écrits (tome II). Paris : Gallimard.
Fourment, É. (2017). Au-delà du conflit générationnel : la conciliation des approches matérialistes et queer dans le militantisme féministe de Göttingen. Nouvelles Questions Féministes, 36(1), 48-65. https://doi.org/10.3917/nqf.361.0048.
Fricker, M. (2007). Epistemic Injustice. Oxford University Press.
Gagnon, J. H., & Simon, W. (2005). Sexual Conduct. The Social Sources of Human Sexuality. New Brunswick : Aldine Transactions. (Originalement publié en 1973).
Gelly, M., & Pitti, L. (2016). Une médecine de classe ? Inégalités sociales, système de santé et pratiques de soins. Agone, 58(1), 7-18. https://doi.org/10.3917/agone.058.0007
Giraud, C. (2016). La vie homosexuelle à l’écart de la visibilité urbaine. Ethnographie d’une minorité sexuelle masculine dans la Drôme. Tracés. Revue de Sciences humaines, 30, 79-102.
Gourarier, M. (2017). Alpha mâle : séduire les femmes pour s’apprécier entre hommes. Paris : Éditions du Seuil.
Gourarier, M., Voros, V., & Walin, F. (2023, juillet). Les humeurs de la masculinité. Communication orale présentée au 3e Congrès International du genre, Toulouse.
Greco, L. (2010). Dispositifs de catégorisation et construction du lien social : L’entrée dans une association homoparentale. Genre, sexualité & société, (4). http://gss.revues.org/index1649.html
Haraway, D. (1988). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. Feminist Studies, 14(3), 575-599.
Harding, S. (1993). Rethinking stand-point epistemology. What is ‘strong objectivity’? In L. Alcoff & E. Potter (Eds.), Feminist Epistemologies (pp. 49-82). Routledge.
Humphreys, L. (2007). Le commerce des pissotières. Pratiques homosexuelles anonymes dans l’Amérique des années 1960. La Découverte.
Jarty, J., & Fournier, T. (2020). “Healthy children, healthy nations” : discipliner les corps reproducteurs pour la santé de qui ? Enfances Familles Générations, 24(1). http://journals.openedition.org/efg/8936
Julien, M. P. (2014). Circulation des objets et pratiques de soin de soi chez les enfants de 9 à 13 ans. Au croisement des identifications : la construction du genre. In S. Sinigaglia-Amadio (Ed.), Enfance et Genre. Modalités et effets de la socialisation sexuée (pp. 143-149). Presses Universitaires de Nancy.
Julien, M. P. (2015). Sujet, subjectivation, subjectivité et sciences sociales. Cahier, 4, 87-106. Nantes : Lestamp.
Koechlin, A. (2022). La norme gynécologique. Ce que la médecine fait au corps des femmes. Éditions Amsterdam.
Laqueur, T. (1992). La fabrique du sexe. Essai sur le corps et le genre en Occident.
Le Borgne-Uguen, F. (2003). Grands-parents : un rôle à composer Un enjeu entre générations, une étape dans le parcours de vie. Empan, 52(4), 77-85. https://doi.org/10.3917/soco.075.0109
Mainsant, G. (2016). Gouvernement des corps. In J. Rennes (Dir.), Encyclopédie critique du genre (pp. 273-282). La Découverte. https://doi.org/10.3917/dec.renne.2016.01.0273
Mardon, A. (2009). Les premières règles des jeunes filles : puberté et entrée dans
l’adolescence. Sociétés contemporaines, 3(75), 109-129. https://doi.org/10.3917/soco.075.0109
Mardon, A. (2011). La génération Lolita: Stragégies de contrôle et de contournement. Réseaux, 168-169(4), 111-132. https://doi.org/10.3917/res.168.0111
Martin, E. (1991). The Egg and the Sperm: How Science Has Constructed a Romance Based on Stereotypical Male-Female Roles. Signs, 16, 485-501.
Masclet, C. (2023). Devenir parents de LGBT Des socialisations minoritaires par ricochet
? Actes de la recherche en sciences sociales, 249(4), 76-95. https://doi.org/10.3917/arss.249.0076
Membrado, M. (2006). Les femmes dans le champ de la santé : de l’oubli à la particularisation. Nouvelles Questions Féministes, 25(2), 16-31. https://doi.org/10.3917/nqf.252.0016.
Memmi, D. (2003). Faire vivre et laisser mourir. Le gouvernement contemporain de la naissance et de la mort.
Mennesson, C. (2011). Socialisation familiale et investissement des filles et des garçons dans les pratiques culturelles et sportives associatives. Réseaux, 168-169(4), 87-110. https://doi.org/10.3917/res.168.0087.
Ménoret, M. (2023). Sociologie et cancérologie : un regard de biais. https://shs.cairn.info/sociologie-et-cancerologie–9782379243806?lang=fr.
Nicaise, S. (2023). Apprendre la sexualité gouine Socialisation militante à la sexualité et incidences sexo-biographiques. Actes de la recherche en sciences sociales, N° 249(4), 54-75. https://doi.org/10.3917/arss.249.0054.
Oudshoorn, N. E. J. (2003). The Male Pill. A Biography of a Technology in the Making. Durham : Duke University Press.
Paillet, A. (2021). Valeur sociale des patient·e·s et différenciations des pratiques des médecins Redécouvrir les enquêtes de Glaser & Strauss, Sudnow et Roth. Actes de la recherche en sciences sociales, 236-237(1), 20-39. https://doi.org/10.3917/arss.236.0020.
Piccand, L. (2015). Mesurer la puberté. La médicalisation de l’adolescence, Suisse 1950-1970. Travail, genre et sociétés, 34(2), 57-72. https://doi.org/10.3917/tgs.034.0057.
Quéré, L. (2021). Du corps au « nous ». Produire un sujet politique par le self-help féministe. (Thèse de doctorat, Université de Lausanne).
Radi, B. (2022). Ici il ne s’est rien passé : Cis-sexisme et politique de l’ignorance en Argentine. In J. Coureau, J. Jarty, & N. Lapeyre (Eds.), Le genre des sciences. Approches épistémologiques et pluridisciplinaires. Le Bord de l’Eau.
Raia, L. (2022). Le sentiment de prise d’autonomie par l’automédication : questionner la fabrique médicale des femmes trans par l’usage d’hormones injectables sans ordonnance. Le carnet des étudiant·e·s du master de sociologie de l’EHESS. https://mastersociologie.hypotheses.org/6047
Renahy, N. (2010). Classes populaires et capital d’autochtonie. Genèse et usages d’une notion. Regards Sociologiques, 40, 9-26.
Rosa, H. (2013). Accélération. Une critique sociale du temps. La Découverte.
Rose, N., & Rabinow, P. (2006). Le biopouvoir aujourd’hui. (F. Keck, Trad.). BioSocieties, 1, 195-217.
Ruault, L. (2017). Le spéculum, la canule et le miroir. Les MLAC et mobilisations de santé des femmes, entre appropriation féministe et propriété médicale de l’avortement (France, 1972-1984) [Thèse de doctorat, Université de Lille].
Rzeszotko-Rutili, M. (2024). Le temps préconceptionnel au prisme des masculinités : mise en circulation des savoirs, adaptation des pratiques, reconduction des injonctions. In E. Boulet & R. Guilloux (Eds.), Enfanter, entre normes médicales et représentations sociales (pp. 27-46). Érès.
Schlagdenhauffen, R. (2014). Parler de sexualité en entretien. Comment rendre publics des propos privés. Hermès, La Revue, 69(2), 34-38. https://doi.org/10.3917/herm.069.0034.
Sobocinska, D. (2023). Scripts d’usage et scripts sexuels au service de la rencontre d’un soir : Analyse de l’utilisation sexuelle de Fruitz et Tinder chez des jeunes urbains hétérosexuels diplômés. Réseaux, 237(1), 93-117. https://doi.org/10.3917/res.237.0093.
Stassin, B. (2023). Personnes trans et soutien social en ligne : Le cas du serveur Paroles Trans Reims. Questions de communication, 43(1), 125-148. https://shs.cairn.info/revuequestions-de-communication-2023-1-page-125?lang=fr.
Sullivan, S., & Tuana, N. (2007). Race and Epistemologies of Ignorance. State University of Sullivan, S., & Tuana, N. (2007). Race and Epistemologies of Ignorance. State University of New York Press.
Teillet, G. (2022). (Se) socialiser par l’entretien. Terrains/Théories , 16, ⟨10.4000/teth.4978⟩. ⟨hal-04010266⟩
Thomé, C. (2016). D’un objet d’hommes à une responsabilité de femmes : Entre sexualité, santé et genre, analyser la métamorphose du préservatif masculin. Sociétés contemporaines, 104(4), 67-94. https://doi.org/10.3917/soco.104.0067.
Verdier, Y. (1979). Façons de dire, façons de faire. La laveuse, la couturière, la cuisinière. Gallimard.
Viveros Vigoya, M. (2018). Les couleurs de la masculinité : Expériences intersectionnelles et pratiques de pouvoir en Amérique latine. La Découverte.
Voléry, I., & Balard, F. (2021). La médicalisation des âges. Presses Universitaires de Nancy.
Voléry, I., & Schrecker, C. (2018). Quand la mort revient au domicile. Familles, patients et soignants face à la fin de vie en hospitalisation à domicile (HAD). Anthropologie & Santé, http://journals.openedition.org/anthropologiesante/3681
Vuattoux, A. (2021). Féminités et masculinités au tribunal pour enfants. In Adolescences sous contrôle : Genre, race, classe et âge au tribunal pour enfants (pp. 43-80). Presses de Sciences Po.