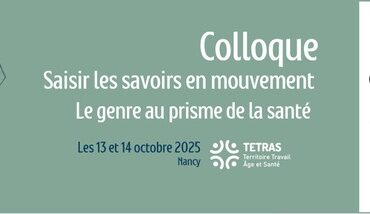Appel à contributions pour le n° 77/2027 de la Revue des Sciences Sociales
Coordination :
Matthieu Quidu, Université Lyon 1 – Laboratoire sur les Vulnérabilités et l’Innovation dans le Sport (L-ViS, UR 7428).
Tristan Fournier, CNRS – Iris, Campus Condorcet de l’EHESS.
Matthieu Delalandre, Université Gustave Eiffel, Laboratoire Analyse comparée des pouvoirs (ACP, EA 3350).
Éric Boutroy, Université Lyon 1 – Laboratoire sur les Vulnérabilités et l’Innovation dans le Sport (L-ViS, UR 7428).
Vivre sans voiture ou habiter en tiny house ; jeûner ou adopter un régime sans gluten, sans sucre ou sans protéine animale ; pratiquer le zéro déchet ou le decluttering (i.e. le désencombrement) ; s’adonner à la randonnée ultralégère, courir pieds nus ou se détacher de l’auto-quantification digitale : qu’est-ce que faire « avec moins » voire « sans » signifie dans une société doublement marquée par une escalade vers le « toujours plus » et une prise de conscience de la raréfaction des ressources ? C’est à cette question générale que souhaite répondre le présent projet éditorial, en s’intéressant à l’adoption intentionnelle de démarches minimalistes à partir d’un prisme singulier : les transformations du corps.
En sciences sociales, certaines pratiques réflexives et critiques à l’égard des logiques du plus ont déjà été abordées : « simplicité volontaire » (Alexander, 2011), « sobriété » (Guillard, 2019), « décroissance » (Latouche, 2006), « consommation engagée » (Dubuisson-Quellier, 2018)… Les phénomènes sous-jacents ont par ailleurs fait l’objet de conceptualisations plus générales, par exemple par le biais des innovations par « détachement et retrait » (Goulet & Vinck, 2022) ou encore par la « distanciation normative » (Stroude, 2021). Ces termes ne sont toutefois pas synonymes et c’est celui de « minimalisme » (Meissner, 2019) que nous avons choisi de retenir ici et de discuter. De notre point de vue, ce concept générique a le mérite d’englober un grand nombre de pratiques sociales organisées selon une logique du less is more : il s’agirait effectivement de faire aussi bien, mieux, voire plus avec moins ou sans. Le minimalisme constitue à la fois une démarche volontaire, une dynamique de réagencements par retrait ainsi que le produit de celles-ci. Selon Dopierała (2017), le minimalisme se caractérise également par une attitude critique vis-à-vis de la consommation marchande, bien que des rapports ambivalents à son égard puissent être identifiés. Si le minimalisme puise ses origines dans les mondes de l’art (Meyer, 2004) et de la religion (où le dépouillement volontaire associé à l’ascétisme deviennent des voies privilégiées d’évolution spirituelle), il s’inscrit également dans une mouvance plus large de stylisation des consommations, susceptible de se muer en un mode de vie global fondé sur un désir d’émancipation et parfois sur un rapport nostalgique à un passé qui aurait été « perdu » ou « dévoyé ».
Le minimalisme peut être investi de significations plurielles de la part de celles et ceux qui le pratiquent : il peut ainsi renvoyer à une dimension politique, à l’instar d’une recherche de réduction de son impact écologique portée par une critique du consumérisme et d’un modèle capitaliste fondé sur la croissance et l’accumulation. Mais le détachement peut également consister en une simplification matérielle de son quotidien dans la perspective d’une prise en charge de son bien-être individuel et de l’optimisation de ses ressources personnelles. L’une des figures contemporaines de cette seconde orientation pourrait être Marie Kondo, consultante japonaise spécialiste du Home organizing et auteure d’ouvrages vendus à des millions d’exemplaires dans le sillon du développement personnel. Sa méthode consiste en premier lieu à se débarrasser du « superflu » de manière à ne conserver que l’« essentiel », qui sera alors ordonné et mis en valeur dans un espace épuré. On le devine, le minimalisme n’est pas nécessairement réductible à une quête écologique ou à une morale frugale, il peut tout à fait s’inscrire dans des ressorts capitalistes (Sandlin & Wallin, 2022). Ce mouvement est en effet arrimé à un marché et ses adeptes peuvent être attirés par une promesse de distinction sociale et d’optimisation de soi (Fournier & Dalgalarrondo, 2024).
L’enjeu du présent numéro spécial est de s’emparer de manière critique de la diversité de ces formes d’appropriation et d’expression du minimalisme. Il s’agira de questionner l’unité éventuelle de ces démarches derrière leur foisonnement apparent, que cela soit en termes de terminologies, de finalités et de moyens.
Il convient d’emblée de préciser que c’est plus précisément aux formes choisies – et donc non subies – du minimalisme qu’est consacré le présent appel. Si les travaux sur la vulnérabilité, la précarité et la pauvreté constituent des objets classiques en sciences sociales ayant contribué à éclairer le déploiement contraint de modes de vie frugaux, c’est ici aux formes délibérées de retrait, de détachement ou de distanciation qu’il s’agira de s’intéresser. Cela n’exclut toutefois pas, bien au contraire, de prendre pour objet les ambivalences du minimalisme, qui peut être perçu et affirmé comme délibéré tout en étant accompagné d’une diminution objective du volume de ressources (en argent, en temps, en espace disponible, etc.). Inversement, les choix qui paraissent parfaitement volontaires peuvent relever de justifications a posteriori et leur analyse révéler des contraintes cachées. Il nous semble donc particulièrement heuristique de travailler cette tension entre une valorisation du moins comme finalité (« moins, c’est mieux ») ou comme moyen d’optimisation (« moins pour faire mieux »). Cela plaide en faveur d’une appréhension du minimalisme dans sa complexité comme dans sa diversité : parler des minimalismes permet alors d’intégrer la multiplicité des manières, des visées et des significations se rejoignant dans l’idée fondamentale de faire sans, de faire moins ou de faire avec moins.
Mais, avant d’être une idée, une rhétorique ou une promesse, le minimalisme est aussi un ensemble de pratiques, de savoir-faire et de techniques. C’est ainsi par le prisme singulier des pratiques corporelles que nous envisagerons l’émergence de ces formes plurielles de minimalisme. En effet, qu’il concerne les manières d’habiter, de consommer, de se déplacer, de se nourrir ou de s’exercer physiquement (liste d’activités non exhaustive), l’engagement dans une dynamique minimaliste implique le corps. Cela suppose en effet d’apprendre de nouvelles techniques corporelles, d’intégrer des sensations et des focalisations attentionnelles inédites, de développer d’autres qualités physiques, de s’engager dans de nouvelles expériences, de découvrir de nouveaux plaisirs. Symétriquement, cela conduit à déconstruire des routines profondément incorporées (Rigal, 2020), à inhiber des perceptions habituelles, à transformer des schèmes moteurs, à domestiquer des sensations originellement déstabilisantes. Le corps apparaît ainsi, du fait de sa plasticité et de sa malléabilité, comme une conséquence en même temps qu’un enjeu du minimalisme. Non plus destin subi, il se mue en projet volontariste (Shilling, 1993) et devient un véritable laboratoire de transformation de soi (Garcia et al., 2024), un support charnel et intime d’expérimentations et de transitions. Que fait le minimalisme au corps ? Dans quelle mesure le corps rend-il possible (mais aussi limite-t-il) la démarche minimaliste ?
Les propositions de contributions pourront s’inscrire sans exclusivité dans l’un des trois axes suivants :
Axe 1 : Les promesses du minimalisme
Le premier axe de questionnement s’intéresse au marché du minimalisme et plus particulièrement aux promesses sur lesquelles s’arriment les pratiques visant à faire sans ou avec moins : économie financière, meilleure santé physique et/ou mentale, découverte de nouveaux plaisirs, vieillissement actif, retour à soi, reconnexion à la nature, engagement politique, préservation de l’environnement, etc. Dans cette perspective, il s’agira d’identifier les promoteurs de ces promesses, les leaders d’opinions minimalistes voire les entrepreneurs de morale et d’analyser leurs discours, leurs stratégies argumentatives, les valeurs, croyances et imaginaires qu’ils véhiculent, mais aussi les controverses qu’ils suscitent. Quelle est la place de la science dans l’argumentaire minimaliste ? Le numérique constituant un espace privilégié de circulation de ces promesses, l’un des objectifs sera d’étudier les contextes (sites Internet, forums de discussion, réseaux sociaux, applications, etc.) dans lesquels les pratiques minimalistes sont promues et les manières dont les corps sont mis en scène, transformés, renforcés, notamment dans une logique d’incarnation, lorsque « le corps est censé dire le vrai » (Hauray & Dalgalarrondo, 2019). On pourra, symétriquement, questionner les formes de médiation ainsi que les réceptions plurielles de ces discours de la promesse chez les minimalistes « ordinaires » ou « profanes » tout en s’efforçant de saisir les aspirations, les motivations et les significations investies par celles et ceux qui s’engagent dans des pratiques minimalistes. Comme indiqué en préambule, celles-ci peuvent renvoyer à des logiques utilitaires d’efficacité et d’efficience constitutives de projets de soin de soi mais aussi d’optimisation de soi et/ou de gestion de ses ressources. Du fait de leur dimension ascétique, certaines pratiques minimalistes peuvent-elles être rapprochées des « technologies » et des « techniques de soi » (Foucault, 1994) ? Par celles-ci, hommes et femmes cherchent à se transformer dans leur être singulier et à faire de leur vie une oeuvre répondant à certains critères de style. En l’occurrence, la stylisation, voire l’esthétisation, du quotidien peuvent résider dans le désir de faire du plus avec du moins. Les démarches minimalistes peuvent aussi mettre en jeu des formes d’autodiscipline, de spiritualité ou encore des considérations économiques, écologiques et/ou éthiques impliquant des formes variées et renouvelées de politisation. C’est alors le faisceau complexe des significations individuelles et/ou collectives sous-tendant les mécanismes de détachement et de distanciation normative vis-à-vis des modèles politiques dominants qu’il s’agira notamment de questionner.
Axe 2 : Pratiquer le minimalisme
Faire sans ou avec moins ne se limite probablement pas à réduire, à retirer ou à se détacher (des équipements matériels, des outils et interfaces numériques, des moyens de transport, d’une partie de l’alimentation, etc.). Il s’agit aussi et peut-être surtout d’apprendre à faire autrement, de construire de nouveaux attachements ou associations (Goulet & Vinck, 2012), ce qui implique l’acquisition de connaissances, de savoir-faire voire de savoir sensibles spécifiques (Boutroy, 2021 ; Madon, 2024). Ceux-ci gagnent à être analysés par le prisme des cultures matérielles (Julien & Rosselin, 2005), des techniques du corps, des changements de modes de consommation et autres reconfigurations des rapports de l’individu à son environnement. L’objectif ici est double.
D’une part, il sera question d’identifier les modalités pratiques sous-tendant et supportant l’engagement minimaliste : quels apprentissages implique-t-il ? Où et comment les acquiert-on ? En termes praxéologiques ou pragmatiques, qu’est-ce que faire sans (des objets, des techniques, des entités, des intermédiaires) ? À l’instar du désencombrement domestique fondé sur l’application systématique de principes et méthodes formalisés par des leaders influents (Gollnhofer et al., 2024 ; Sandlin & Wallin, 2022), le minimalisme passe-t-il nécessairement par la mise en oeuvre d’un véritable système technique ? Quelles contraintes et difficultés cela pose-t-il au quotidien et réciproquement quelles ressources se trouvent-elles engagées et renforcées dans un tel processus ? À ce titre, une attention pourrait être accordée à l’environnement social : entre leviers et contraintes, quels rôles jouent les autruis significatifs dans l’adoption de pratiques minimalistes ? Quelle est la place des communautés de pratique dans la formalisation, le partage et l’incorporation de ces savoir-faire minimalistes (Boutroy, 2022) ?
D’autre part, si le minimalisme constitue un ensemble de pratiques qu’il convient de décrire minutieusement, celles-ci ne sont pas nécessairement adoptées de manière équivalente par l’ensemble de la population. Qui sont les personnes s’engageant de manière significative dans une démarche minimaliste ? Qui sont les acteurs la revendiquant, assumant son inscription dans une forme de politisation, y compris dans le quotidien (Pruvost, 2024) ? Qui sont, à l’inverse, ceux qui maintiennent leur engagement dans un registre plus individuel, tacite ou dépolitisé ? L’adoption du minimalisme constitue-t-elle l’apanage des classes moyennes éduquées réputées être les plus réflexives sur leur corps (Boltanski, 1971), leur alimentation (Régnier et al., 2006) et l’environnement (Coulangeon et al., 2023), et donc les plus à même de s’engager dans une réforme de soi ? Faire avec moins lorsque la norme dominante porte au toujours plus ne constitue-t-il pas aujourd’hui une forme reconfigurée de distinction et de singularisation (Reckwitz, 2020), notamment typique des « classes aspirationnelles » (Currid-Halkett, 2017), déjà nanties en biens matériels mais désireuses d’un surplus culturel et spirituel ? Vivre, même temporairement, une tranche de vie (de) minimaliste ne revient-il pas parfois à ajouter une énième expérience à sa liste de moments à vivre dans une existence sécularisée et dans le contexte d’une « société de l’expérience », nouvel avatar du consumérisme (Miles, 2024) ? Assiste-t-on plutôt à des usages bigarrés des minimalismes en fonction des appartenances et conditions sociales (classe, genre, âge…) ? Hommes et femmes sont-ils ou elles engagé·es de manière analogue dans les démarches minimalistes ? Qu’en est-il, en premier lieu, des pratiques corporelles spécifiques ? Citons par exemple les processus de détachement vis-à-vis du soutien-gorge (Dubois & Berg, 2022) ou encore des protections hygiéniques « classiques » (serviettes ou tampons jetables). Concernant ce dernier cas, l’utilisation de méthodes alternatives en temps de menstrues, dans laquelle se mêlent des considérations sanitaires et écologiques, implique des apprentissages sensoriels et intimes qui sont décrits comme procédant d’une véritable « conversion » (Dutrait, 2022). De surcroît, il s’agira de saisir dans quelle mesure la pratique du minimalisme se fait l’écho d’une socialisation genrée : recompose-t-elle, déstabilise-t-elle ou, à l’inverse, consolide-t-elle l’ordre du genre ?
Par ailleurs, existe-t-il des indices d’une diffusion sociale, voire d’une démocratisation, du minimalisme volontaire ? Quel est le poids des influences socialisatrices (primaires et secondaires) dans la volonté et la capacité d’adoption ainsi que de maintien de pratiques minimalistes ? La variété des dispositions incorporées débouche-t-elle sur des pratiques différenciées ?
Axe 3 : Espaces et temporalités du minimalisme
L’engagement dans une dynamique minimaliste reconfigure également les rapports charnels au temps et à l’espace. Vivre dans une tiny house, se déplacer sans voiture, vivre sans téléphone portable, être végétarien ou courir pieds nus impliquent en effet un renouvellement objectif des distances et des durées comme de leur perception. La patience, la constance et la persévérance, par opposition à la précipitation et la versatilité, apparaissent par exemple comme des qualités fondamentales mises en avant par les pratiquants minimalistes de musculation (Favier- Ambrosini, Delalandre & Quidu, 2022). Le minimalisme est-il toutefois cantonné à la lenteur et, du côté topographique, à son espace proche ? Devenir minimaliste, est-ce se détacher pour mieux se reconnecter à son milieu, que celui-ci soit urbain (ex. : le réinvestissement des lieux publics par les pratiquants de Parkour) ou naturel (ex. : dans une optique de réensauvagement, qui peut passer par une activité de cueillette de plantes sauvages) ? Dans quelle mesure l’adoption de pratiques voire de modes de vie minimalistes reconfigure-t-elle les rapports noués à l’autre, à la nature et à soi-même, éventuellement dans le sens d’une résonance (Rosa, 2018) ?
Penser les temporalités du minimalisme, c’est également resituer l’engouement (apparemment) contemporain pour le moins dans l’épaisseur de l’histoire, de ses cycles et de ses diastoles et systoles alternativement maximalistes et minimalistes. Dans quelle mesure des méthodes minimalistes diffusées et commercialisées dans le premier quart du 21ème siècle empruntent-elles à, mais aussi réactualisent-elles, des démarches produites antérieurement, aussi bien dans leurs contenus pratiques que dans leur résonance symbolique, à l’instar de l’imaginaire « paléo » (Weedon & Patchin, 2021) ou « primitiviste » (Dalgalarrondo & Fournier, 2020) ? Dans le domaine des méthodes de culture physique, Fortune & Attali (2022) montrent par exemple comment le MovNat, cet art du déplacement en milieu naturel, puise, tout en l’ajustant aux contraintes d’un marché du fitness renouvelé et mondialisé, dans la « Méthode naturelle » de Georges Hébert formalisée un siècle plus tôt.
Se détacher pour se reconnecter (à soi, aux autres, à son environnement) doit également être conceptualisé comme un processus inscrit dans la durée, une dynamique, un devenir, une transition. Un enjeu réside ici dans la formalisation des carrières vers, mais aussi dans, le minimalisme : comment entre-t-on dans une démarche minimaliste ? Des périodes de la vie sont-elles plus propices au questionnement critique des logiques du toujours plus ? Quelle est la place des socialisations antérieures et/ou des tournants majeurs, des ruptures biographiques, des bifurcations (Bessin et al., 2010) et autres expériences radicales de conversion ? Comment s’y maintient-on et s’y développe-t-on ? Quels sont les facteurs qui en assurent l’étayage ? Certaines configurations domestiques et familiales sont-elles favorables ou au contraire contraignantes dans la pérennisation des changements amorcés ? Peut-on dégager des séquences de carrières minimalistes ? Devenir minimaliste dans un domaine (par exemple en adoptant un régime végétalien) demeure-t-il circonscrit au seul cadre alimentaire ou s’étend-il en cascade aux divers pans de son existence ? Ce mécanisme de cumul, de diffusion ou d’engrenage est-il systématique ? Comment fonctionne-t-il ? Des dissonances intra-individuelles entre domaines peuvent-elles se maintenir ? Mais aussi, certaines personnes sortent-elles du minimalisme ? Si oui, comment et pourquoi (saturation, épuisement, changement familial…) ? En définitive, l’engagement dans une démarche minimaliste est ici envisagé comme une dynamique non linéaire, processuelle avec ses incertitudes, ses vicissitudes, son lot éventuel de déceptions ou de frustrations voire ses dérives et retours en arrière. Comment se transforme-t-on individuellement au contact du minimalisme et pour devenir minimaliste ? Dans quelle mesure cette modification s’ancre-t-elle dans le corps, en contribuant à forger de nouvelles dispositions ? Il s’agira de tenter de penser conjointement les reconfigurations des rapports au temps et à l’espace induites par le minimalisme en posant l’hypothèse selon laquelle la transformation de l’un se ferait rarement sans affecter l’autre.
Les contributions rassemblées dans ce numéro spécial alimenteront un ou plusieurs des axes précédents à partir d’enquêtes de terrains variées, mais se rejoignant dans la mise en évidence de l’importance du corps, de ses pratiques, de ses techniques, de ses émotions et de ses transformations dans la démarche minimaliste. Ces questionnements pourront être abordés par une variété d’éclairages disciplinaires (sociologie, histoire, anthropologie, géographie, sciences politiques, sciences de l’information et de la communication) et de modèles théoriques.
Nous invitons les auteur·e·s à soumettre avant le 15 novembre 2025 leur proposition d’article sous la forme d’un résumé de 4 000 signes maximum. La proposition devra mentionner l’axe dans lequel l’article s’inscrit, le titre, le cadre théorique, les matériaux empiriques, le ou les terrains, les sources et la méthodologie. Le résumé doit comporter également une bibliographie de référence (en dehors des 4 000 signes) et une courte présentation des auteur·e·s.
Les propositions sont à envoyer conjointement à l’adresse de la revue, rss@misha.fr ainsi qu’aux quatre coordinateurs du dossier :
Matthieu Quidu : matthieu.quidu@univ-lyon1.fr
Tristan Fournier : tristan.fournier@ehess.fr
Matthieu Delalandre : matthieu.delalandre@univ-eiffel.fr
Eric Boutroy : eric.boutroy@univ-lyon1.fr
Si la proposition est acceptée, l’article original (40 000 signes maximum) doit être remis avant le 15 mai 2026.
Le numéro paraîtra au 1er semestre 2027.
Les auteurs et les autrices sont prié·e·s de se conformer aux normes éditoriales de la revue qui peuvent être consultées en ligne : https://journals.openedition.org/revss/299.
Bibliographie
Alexander, S. (2011). The Voluntary Simplicity Movement: Reimagining the Good Life Beyond Consumer Culture. SSRN.
Bessin, M., Bidart, C. & Grossetti, M. (2010). Bifurcations. Les sciences sociales face aux ruptures et à l’événement. Paris, La Découverte.
Boltanski, L. (1971). Les usages sociaux du corps. Annales, 26(1), 205-233.
Boutroy, É. (2022). « Un wikipedia de la randonnée légère » : savoir-faire en libre accès au sein d’une communauté de pratique en ligne. Ethnologie Française, 52(1), 91-106.
Boutroy, É. (2021). Minimalism and Lightweight Backpacking in France: A Material Culture of Detachment. Consumption Markets Culture, 24(4), 357-372.
Coulangeon, P., Demoli, Y., Ginsburger, M. & Petev, I. (2023). La conversion écologique des Français. Contradictions et clivages. Paris, PUF.
Currid-Halkett, E. (2017). The Sum of Small Things. A Theory of the Aspirational Class. Oxford, Princeton University Press.
Dalgalarrondo, S. & Fournier, T. (2020). L’utopie sauvage : enquête sur notre irrépressible besoin de nature. Paris, Les Arènes.
Dopierała, R. (2017). Minimalism, a new mode of consumption? Przeglad Socjologiczny, 66(4).
Dubois, B. & Berg, F. (2022). La clinique du coureur. Angoulême, Mons.
Dubuisson-Quellier, S. (2018). La consommation engagée. Paris, Presses de Sciences Po.
Dutrait, C. (2022). Faire avec le flux. Tampons, coupes, complications et implications : ce qu’impliquent les techniques du temps des règles. Techniques & culture, 77.
Favier-Ambrosini, B., Delalandre, M. & Quidu, M. (2022). Revendiquer l’innovation dans le champ de la culture physique : étude de trois méthodes contemporaines. Loisir et Société, 46, 109-135.
Foucault, M. (1994). Dits et écrits, 1954-1988. Tome IV, 1980-1988. Paris, Gallimard.
Fournier, T. & Dalgalarrondo, S. (2024). From Self-Optimization to Minimalism and Back. The Promises and Practices of Fasting in France. Historical Social Research, 49(3), 102-122.
Fortune, Y. & Attali, M. (2022). MovNat ou la Méthode naturelle revisitée. In J-F. Loudcher et al. (dirs), Héritages sportifs et dynamiques patrimoniales. Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée.
Garcia, M-C. et al. (2024). En quête de contrôle de soi : ressorts de l’engagement dans la pratique du yoga d’individus diplômés du « supérieur long ». Regards Sociologiques, 61/62, 35-50.
Gollnhofer, J. F., Bhatnagar, K. & Manke, B. (2024). The Discomfort of Things! Tidying-up and Decluttering in Consumers’ Homes. Journal of Consumer Research, https://doi.org/10.1093/jcr/ucae034.
Goulet, F. & Vinck, D. (dirs.) (2022). Faire sans, faire avec moins. Les nouveaux horizons de l’innovation. Paris, Presse des Mines.
Goulet, F. & Vinck, D. (2012). L’innovation par retrait. Contribution à une sociologie du détachement. Revue Française de Sociologie, 53(2), 195-224.
Guillard, V. (dir.). (2019) Du gaspillage à la sobriété : avoir moins et vivre mieux ? Louvain-la-Neuve, De Boeck
Julien, M-P. & Rosselin, C. (2005). La culture matérielle. Paris, La Découverte.
Hauray, B. & Dalgalarrondo, S. (2019). Incarnation and the Dynamics of Medical Promises: DHEA as a Fountain of Youth Hormone. Health, 23(6), 639-655.
Latouche, S. (2006). Le pari de la décroissance. Paris, Fayard.
Madon, J. (2024). Faire durer les objets : pratiques et ressources dans l’art de déconsommer. Paris, Presses de Sciences Po.
Meissner, M. (2019). Against accumulation: lifestyle minimalism, de-growth and the present post-ecological condition. Journal of Cultural Economy, 12(3), 185-200.
Meyer, J. (2004). Minimalism: Art and Polemics in the Sixties. Yale University Press.
Miles, S. (2024). La société de l’expérience : le consumérisme réinventé. Paris, L’échappée.
Pruvost, G. (2024). Quotidien politique. Féminisme, écologie, subsistance. Paris, La Découverte.
Reckwitz, A. (2020). Society of singularities. Cambridge, Polity Press.
Régnier, F., Lhuissier, A. & Gojard, S. (2006). Sociologie de l’alimentation. Paris, La Découverte.
Rigal, A. (2020). Habitudes en mouvement : vers une vie sans voiture ? Genève, Métis Presses.
Rodriguez, J. (2018). The US Minimalist Movement: Radical Political Practice? Review of Radical Political Economics, 50(2), 286-296.
Rosa, H. (2018). Résonance : une sociologie de la relation au monde. Paris, La Découverte.
Sandlin, J. A. & Wallin, J. J. (2022). Decluttering the Pandemic: Marie Kondo, Minimalism, and the “Joy” of Waste. Cultural Studies, 22(1), 96-102.
Shilling, C. (1993). The Body and the Social Theory. London, Sage.
Stroude, A. (2021). Vivre plus simplement. Analyse sociologique de la distanciation normative. Québec, Presses de l’Université Laval.
Weedon, G. & Patchin, P. (2021). The Paleolithic imagination: Nature, science, and race in Anthropocene fitness cultures. Environment and Planning E: Nature and Space, 5(2), 719-739.