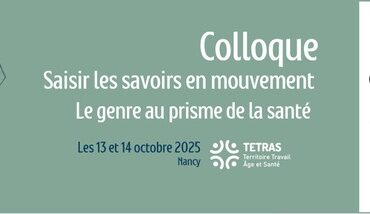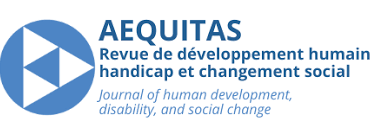Les savoirs scientifiques de la performance sportive : constructions, circulations, usages
Revue d’anthropologie des connaissance
Site de la revue: https://journals.openedition.org/rac/39698
Thématique de l’appel
La performance sportive est-elle produite en laboratoire ? Si l’on en croit certains discours institutionnels et médiatiques, l’analyse biomécanique du mouvement, la mesure physiologique de l’état de forme ou encore l’étude des rythmes biologiques du sportif sont devenus incontournables, essentiels à l’obtention des médailles. La performance sportive serait donc indissociable d’une analyse scientifique de ses conditions de réalisation ; réciproquement, le terrain sportif contribuerait à l’enrichissement des modèles théoriques issus de la recherche en laboratoire. Les institutions scientifiques elles-mêmes tendent à renforcer ce point de vue, qui à la fois légitime et valorise le travail des chercheurs, et participe à la mise en récit de la performance sportive (Jönsson, 2019 ; Mignon, 2007).
Cet appel à contributions vise à approfondir la compréhension des liens entre sport et sciences en articulant deux niveaux d’analyse : celui des processus de production des savoirs scientifiques sur les performances sportives et celui de leurs usages. Il s’agit d’interroger leurs multiples formes de déplacements, de reformulations et de mobilisations, et d’explorer les frontières, les relations et les superpositions entre leurs espaces de production et d’appropriation, lesquels peuvent se confondre ou être disjoints. Ce faisant, c’est aussi la façon dont la science participe de la définition des performances sportives qui pourra être questionnée.
Les science and technology studies se sont largement intéressées aux agencements sociotechniques, aux acteurs et aux lieux de mise en circulation des savoirs académiques, à leurs canaux de diffusion, aux logiques économiques sous-jacentes à l’édition scientifique ou encore aux inégalités engendrées par la façon dont les savoirs circulent (Keim et Rodriguez Medina, 2023). Pourtant, bien que des travaux récents aient porté l’attention sur le sport, en examinant par exemple le recours à l’intelligence artificielle (Sterling, 2022), en étudiant les stades comme des infrastructures en réseau (Yang et Cole, 2020 ; Robertson et Nyaupane, 2024), ou encore en s’attardant sur les innovations techniques (Boutroy, Soulé et Vignal, 2014 ; Soulé et al., 2021), peu nombreux sont ceux qui se sont intéressés aux savoirs scientifiques sur la performance, celle-ci étant le plus souvent abordée à travers les thématiques dominantes de la sociologie du sport : différenciations sexuées, médiatisation, comportements déviants, violences, etc. (Demazière, Ohl et Le Noé, 2015). Ce numéro thématique ambitionne à la fois d’élargir les terrains habituellement investis par les science and technology studies et de contribuer à la saisie des dynamiques complexes de (co)production, de circulation, d’hybridation et de mise à l’épreuve des savoirs scientifiques dans des contextes où leur validité est sans cesse testée.
La mobilisation des sciences dans la production de la performance sportive est la conséquence d’un processus de rationalisation du sport à l’œuvre depuis le début du XIXe siècle, et qui semble se poursuivre encore aujourd’hui (Mignon, 2002 ; Fleuriel, 2013). La place de la recherche biomédicale a été particulièrement importante dans cette évolution, notamment à partir des années 1920 (Wrynn, 2010), le recours à la science comme moyen d’améliorer les performances s’intensifiant dans les années 1960 (Mignon, 2002). L’institutionnalisation des savoirs scientifiques sur le corps performant s’est donc d’abord faite en médecine et en physiologie, avant de s’étendre aux autres disciplines scientifiques. Elle s’est traduite par la constitution d’associations savantes, comme l’American college of sports medicine (Berryman, 1995) ou la création de laboratoires comme le prestigieux Harvard fatigue laboratory (Johnson, 2015). Les études sur la production des savoirs scientifiques ont ainsi surtout retracé leur histoire, et se sont focalisées principalement sur la physiologie de l’exercice, dont le développement a été étroitement lié à ses usages, que ceux-ci se rapportent à des préoccupations hygiénistes (Berryman, 2010), productivistes (Scheffler, 2011) ou sportives (Berryman et Park, 1992 ; Massengale et Swanson, 1997 ; Heggie, 2011 ; Carter, 2012). Bien que centrés sur les savoirs académiques, ces recherches laissent apparaître la porosité des frontières entre espaces de production et d’appropriation des savoirs.
Certains travaux en ont approfondi l’examen, en prenant davantage en considération les technologies matérielles. Ainsi, Svensson et Sörlin (2019) proposent l’une des rares enquêtes étudiant au plus près des acteurs la façon dont les savoirs sont produits, circulent et sont mobilisés. Les auteurs montrent, dans une perspective sociotechnique, la façon dont le laboratoire est devenu dans les années 1960-1970 un « point de passage obligé » (Callon, 1986 ; Latour, 1989) pour les skieurs de fond suédois, les chercheurs alignant leurs intérêts avec ceux des sportifs. Les tests conçus par les chercheurs, qualifiés de « technologies de sportification », ont joué un rôle déterminant dans ce processus, et sont devenus progressivement de plus en plus importants, et même indispensables, dans le sport de haut niveau (Svensson, 2016). Le travail de mesure, en tant que dispositif produisant des savoirs utilisés à la fois par les acteurs sportifs et les chercheurs, s’appuie sur des instrumentations (capteurs de forces, dispositifs de suivi physiologiques, etc.) qui constituent des formes de matérialisation d’intérêts hétérogènes (Star et Griesemer, 1989), mais qui contribuent aussi, en véhiculant des standards, à des formes d’impositions (Delalandre, Collinet et Terral, 2012). Quand bien même les technologies de mesure permettent aux chercheurs d’investir les terrains de sport en se rendant « invisibles » (Johnson, 2020), la science, en tant que langage de vérité, impose des formes de description du réel, et peut aussi susciter des résistances (Roger, 2006 ; Wrynn, 2010 ; Svensson et Sörlin, 2019). Les dispositifs de mesure et d’analyse du sportif « embarquent » des modèles théoriques (physiologiques, biomécaniques, etc.) qui génèrent leurs propres problématiques et questionnements, et qui impliquent le recours à des métrologies spécifiques dont doivent s’emparer les praticiens (les courbes force-vitesse pour caractériser la puissance d’un sportif, la variabilité de la fréquence cardiaque pour évaluer son état de forme ou encore la consommation maximale d’oxygène pour évaluer son endurance). De ce fait, ils contribuent aussi à la définition – ou à la redéfinition – de ce qu’est être performant par l’usage de ces métrologies, de normes, de tests qui deviennent des « points de passage obligés » (Svensson et Sörlin, 2019) participant du façonnage des corps et des pratiques.
Gibson (2018), tout comme Hoberman (1992), a mis en lumière les dynamiques de « déshumanisation » (i.e. l’élimination des dimensions sociales et de l’expérience humaine dans les processus de production de connaissances) résultant de ces processus. Mais les acteurs sportifs ne sont pas pour autant des réceptacles passifs de savoirs produits par d’autres : au contraire, les savoirs scientifiques font l’objet de réappropriations et d’hybridations qui ne se réduisent pas à une forme de dévoiement. Ils sont mobilisés comme ressources permettant de donner du sens aux pratiques, mais n’ont pas nécessairement valeur de prescription pour l’action (Collinet, 2006). Les experts scientifiques sont en outre eux-mêmes mis à l’épreuve, leur accès au terrain étant conditionné par une acceptation des directions techniques des fédérations sportives, des entraîneurs, des athlètes.
Les rapprochements entre producteurs et usagers des savoirs ne débouchent d’ailleurs pas nécessairement sur une conception prescriptive de la recherche (Delalandre, 2012) faisant des praticiens de simples « applicateurs » de théories construites par les chercheurs. À cet égard, les normes de scientificité, les rapports entre la science et ses applications sont mis en débat, contestés, disputés et se reconfigurent, y compris dans les sciences du sport (Terral, Collinet et Delalandre, 2009). La recherche semble aujourd’hui devoir éclairer et non pas nécessairement être appliquée ; elle s’ancre dans des questionnements formulés par les professionnels (Delalandre, 2012). On observe des co-constructions des savoirs de l’entraînement, intégrant à la fois les savoirs scientifiques et les savoirs et savoir-faire issus du monde sportif (Boyer, Rochat et Rix-Lièvre, 2023 ; Rix-Lièvre, Héros, Récopé, 2025), ce qui ne doit toutefois pas conduire à ignorer les tensions qui marquent à la fois les relations entre acteurs et savoirs, parfois fondés sur des épistémologies incompatibles (Kerr, 2016).
Cette émergence de la figure de l’expert scientifique dans l’entraînement sportif s’inscrit dans un mouvement plus général de division et de spécialisation du travail de production de la performance, qui implique la participation d’un ensemble hétérogène d’acteurs coordonné par les entraîneurs (Burlot et Julla-Marcy, 2018). Ces derniers ne sont pas les seuls usagers des savoirs scientifiques à des fins d’amélioration des performances. Certains métiers, notamment ceux de préparateur physique ou mental ont émergé, se sont développés et professionnalisés (Bourdoncle, 2000), en faisant valoir une expertise fondée en partie sur la maîtrise de savoirs scientifiques. Si l’intérêt d’en développer une analyse sociologique a pu être souligné (Mills et Gearity, 2016), les travaux sur le sujet restent rares. Ils ont porté sur les rapports de genre (Thomas, Devine et Molnár, 2022), ou ont pu aborder les pratiques des préparateurs physiques comme l’exercice d’un pouvoir disciplinaire, dans une perspective foucaldienne (Kuklick et Gearity, 2022). La formation a aussi fait l’objet d’une certaine attention (Szedlak et al., 2024 ; Kern, Bellar et Wilson, 2023), sans pour autant que les savoirs mobilisés par les professionnels aient été pris comme objet d’analyse.
Le data tracking constitue une autre figure contemporaine d’expertise, porteuse de promesses qui ont fait l’objet d’analyses critiques mettant en évidence sa fonction disciplinaire (Jones, Marshall et Denison, 2016 ; Dalgalarrondo, 2018 ; Toner, 2023). Les recherches menées dans le milieu du rugby professionnel montrent que la collecte de données par des dispositifs contenant divers appareils de mesure (cardiofréquencemètre, global positioning system (GPS), accéléromètre, etc.) aboutit à la mise en transparence des organismes, dans une logique de surveillance biomédicalisée, sous couvert d’une triple promesse d’optimisation des performances, de ludification du travail sportif et de prévention, notamment en ce qui concerne les commotions (Jones, Marshall et Denison, 2016 ; Dalgalarrondo, 2018). Récemment, Ventresca (2020) a d’ailleurs montré que la réduction des risques encourus à la seule dimension biomédicale de la pratique sportive peut constituer un frein à la compréhension des contextes de survenues des traumatismes.
Le risque semble, de ce point de vue, inhérent à la rationalisation de la préparation à la performance. En effet, dans un contexte où les temporalités sportives se densifient (Burlot et Julla-Marcy, 2018), la recherche des meilleurs moyens de pouvoir tolérer des charges d’entraînement considérables est un enjeu crucial. Face à ce constat, il paraît difficile de s’affranchir d’une réflexion sur le dopage et la façon dont les savoirs biomédicaux sur les produits dopants circulent et sont réappropriés, notamment chez celles et ceux qui les consomment (Le Noé et Trabal, 2008), la qualification de « dopant » pouvant d’ailleurs constituer un objet de controverse opposant des expertises scientifiques. Symétriquement, on pourra questionner le secteur de l’antidopage (Trabal et Zubazarretta, 2020) où la circulation des normes et des savoirs, au sens géographique, mais aussi sectoriel (politique, juridique, etc.), fait l’objet de tensions et se heurte à des conflits de juridiction (Demeslay, 2013, 2019).
Cette attention aux dimensions techniques et épistémiques de la production et des usages de la science ne doit pas occulter ses dimensions politiques. Celles-ci sont prégnantes dans le domaine de la lutte antidopage mais pas seulement. Les sciences et les technologies ont contribué et contribuent encore à maintenir, voire à renforcer, des rapports de force. Elles ont légitimé, en les naturalisant, des hiérarchies raciales (Gould, 1997). Le déterminisme biologique a servi à renforcer les stéréotypes, en réduisant la causalité des réussites sportives des afro-américains à des traits physiques prétendument spécifiques (Miller, 2004 ; Martin-Breteau, 2010 ; Sailes, 2010), la normalisation des « différences raciales » n’étant pas remise en question par les recherches en sciences du sport (Spracklen, 2008). Celles-ci ont pu asseoir des politiques discriminantes au sein des institutions sportives, comme le montrent Carter et Dyson (2015) ou encore McDonald (2020) à propos de la National Collegiate Athletic Association aux États-Unis. Ce sont aussi les conceptions normatives et hiérarchisées du sexe que la science a renforcé. La qualification sexuée des corps en référence à des expertises biomédicales – contrôle gynécologique, test du corpuscule de Barr, puis test PCR/SRY – visant à déterminer le sexe biologique (Bohuon, 2008) ou s’appuyant sur la détermination de seuils hormonaux (Pape, 2019), a conduit à l’imposition de catégories binaires qui excluent une partie des athlètes (Pape, 2020). Bohuon (2008) montre en outre comment, confronté à l’impossibilité d’une définition univoque du sexe biologique, le milieu médical a introduit, pour maintenir la bicatégorisation homme/femme, la notion de féminité, définie en référence à des normes dominantes.
De façon plus générale, ces travaux invitent à interroger les opérations de catégorisation. Celles-ci sont également prégnantes dans le domaine du handisport ; elles y sont parfois transgressées, mais font aussi l’objet de contestations révélant la spécificité de l’idéologie paralympique : s’il s’agit de garantir la participation équitable de ceux qui ont « très peu » de capacités, on peut aussi être exclu si l’on est trop performant (Marcellini, 2016). Le recours aux expertises – et contre-expertises – scientifiques intervient ainsi dans la fixation des normes. Le cas emblématique d’Oscar Pistorius, exclu temporairement des compétitions internationales en 2008 au motif que ses prothèses auraient constitué un avantage sur les valides, illustre cette tension : si le sport de haut niveau valorise le dépassement (de soi et des autres) par le recours aux technosciences, il pose une limite dès lors que le dépassement excède ce que l’on considère être les frontières biologiques de l’humain (Marcellini et al., 2010).
Ce dossier thématique a pour ambition de contribuer à ces débats en saisissant, par des propositions s’appuyant sur des études empiriques, la manière dont les savoirs scientifiques sur la performance sportive sont construits, circulent, et sont utilisés.
Ils pourront aussi explorer des contextes et des pratiques qui ont été peu étudiés sous cet angle, par exemple en examinant l’effet des réseaux sociaux sur les dynamiques de circulation des savoirs. En effet, les athlètes eux-mêmes discutent les choix de leurs entraîneurs en fonction d’informations glanées sur les réseaux sociaux (Burlot et al., 2023). Alors que les algorithmes utilisés par les moteurs de recherche et les réseaux tendent à favoriser certains biais cognitifs (Robertson et al., 2018 ; Cinelli et al., 2021), une perspective de recherche féconde pourrait être de questionner les formes de réception et de réappropriation des savoirs scientifiques circulant sur internet.
Les propositions d’articles devront permettre de comprendre les dynamiques d’interaction entre les différents acteurs – humains et non humains – impliqués dans la construction et la circulation des savoirs scientifiques sur la performance. Elles interrogeront leurs déplacements, usages et non usages. Ce faisant, l’attention pourra être portée sur les contextes de production et d’appropriation des savoirs, en prenant en considération leurs dimensions spatiales (lieux d’expérimentation, de compétition, d’entraînement), temporelles (rythmes de la recherche versus temporalité sportive), matérielles (instrumentations et technologies utilisées), institutionnelles (fédérations, institutions académiques, etc.) et symboliques. Cet appel propose de structurer la réflexion autour de trois axes thématiques.
- La constitution de nouvelles professions
L’essor de nouvelles professions visant l’amélioration des performances sportives n’a été que peu étudié. Les propositions pourront se focaliser sur des métiers nés de la division du travail de production de la performance : préparateurs physiques, préparateurs mentaux, data analysts, etc. Elles questionneront la façon dont les avancées scientifiques et les attentes exprimées par les acteurs sportifs contribuent à l’émergence de nouveaux métiers, à leur redéfinition, à leur professionnalisation.
Il s’agira d’interroger les savoirs mobilisés dans ces pratiques professionnelles, les références invoquées, les formes de légitimation qu’ils permettent. On pourra aussi se demander comment les savoirs produits par les chercheurs ont pu acquérir une certaine légitimité et investir les terrains sportifs, et réciproquement questionner les résistances qu’ils suscitent.
Les contributions pourront ainsi analyser ces professions comme des lieux d’hybridation, d’articulation, et/ou de conflit entre des savoirs académiques et d’autres formes de savoirs (professionnels, expérientiels, etc.). Les rapports de force enfin, pouvant résulter du chevauchement des territoires professionnels d’acteurs s’appuyant sur des corpus de savoirs différents (préparateur physique et kinésithérapeute, préparateur mental et entraîneur, etc.) constituent un autre angle d’analyse possible.
- Les agencements sociotechniques au service de la performance
Les contributions pourront explorer les formes d’agencements sociotechniques impliquant experts scientifiques, entraîneurs, préparateurs physiques, athlètes, référents scientifiques des fédérations sportives, etc. dans la co-construction des savoirs. Dans cette perspective, une attention particulière pourra être portée sur le rôle des technologies. Comment les capteurs de force, les instruments de mesure transportables ou les dispositifs de captation vidéo transforment-ils les relations entre scientifiques et acteurs de terrain ? Quelles formes de coordination autorisent-ils ? Quelles contraintes génèrent-ils ? Dans quelle mesure permettent-ils vraiment de concilier des intérêts et des visions du monde hétérogènes ? Quel rôle jouent-ils dans la définition et le façonnage de la performance ? De quelle manière ont-ils véhiculé des normes, participé à la genèse ou à la reproduction des inégalités et des hiérarchies (raciales, genrées, etc.) ?
Il s’agira ici d’aller au-delà des discours de légitimation habituels, qui mettent en récit une performance sportive assistée par la science et la technologie, pour questionner les interactions entre les acteurs impliqués au sein des différents espaces de production et d’usage des savoirs scientifiques.
- Circulation des savoirs : usages et non usages
C’est enfin sur la circulation des savoirs scientifiques que pourront se centrer les articles. Comment circulent-ils entre les différents espaces et comment sont-ils transformés au cours de ces circulations ? Quels en sont les supports, matériel et immatériels ? Quels sont leurs usages, et les conditions de possibilité de ces usages ? On pourra alors questionner le recours au data tracking et, de façon générale, aux outils numériques (applications, outils connectés, etc.). On pourra aussi s’interroger sur la façon dont de nouvelles pratiques peuvent engendrer des questionnements scientifiques et nourrir le travail de recherche. Il s’agira alors d’échapper à une conception top-down, peu révélatrice des dynamiques de circulation des savoirs.
Les propositions pourront examiner les formes d’hybridation des savoirs scientifiques et pratiques, ou les innovations liées à l’appropriation des savoirs produits par la recherche. Les formes de réappropriation successives opérées par différents médiateurs, et les controverses qu’elles suscitent, seraient aussi particulièrement intéressantes à analyser. À cet égard, les réseaux sociaux mériteraient une attention particulière. De façon symétrique, il serait heuristique d’interroger ce qui peut contraindre ou faire obstacle à la circulation des savoirs.
Les analyses pourront s’appuyer sur des récits d’enquête, afin de documenter, dans une perspective réflexive, les effets – et/ou l’absence d’effet – qu’ont pu avoir les recherches produites, y compris en sciences humaines et sociales.
Ces trois axes de réflexion ont pour fonction de fournir un cadrage, mais ils ne prétendent pas à l’exhaustivité, ni à l’exclusivité (un article peut se positionner à l’intersection de plusieurs axes). Les propositions d’articles pourront être issues des différentes disciplines des sciences humaines et sociales : sociologie, anthropologie, histoire, ergonomie, etc.
Modalités de soumission
Les textes complets des articles, au format de la Revue d’Anthropologie des Connaissances (maximum 65 000 signes) seront à soumettre en ligne sur le site de la revue – https://rac.inra-ifris.org/index.php/rac/index – avant le 1er mars 2026.
Les auteur·rices ne doivent pas hésiter à contacter les coordinateurs du dossier avant de soumettre leur proposition : Matthieu Delalandre (matthieu.delalandre@univ-artois.fr) et Géraldine Rix-Lièvre (geraldine.rix@uca.fr).
Bibliographie
Berryman, J. W. (1995). Out of many, one: A history of the American College of Sports Medicine. Human Kinetics.
Berryman, J. W. (2010). Exercise is medicine: A historical perspective. Current Sports Medicine Reports, 9(4), 195–201. https://doi.org/10.1249/JSR.0b013e3181e7d86d
Berryman, J. W., & Park, R. J. (1992). Sport and exercise science: Essays in the history of sports medicine. University of Illinois Press.
Bohuon, A. (2008). Sport et bicatégorisation par sexe : test de féminité et ambiguïtés du discours médical. Nouvelles Questions Féministes, 27(1), 80-91. https://doi.org/10.3917/nqf.271.0080
Boutroy, E., Soulé, B., et Vignal, B. (2014). Analyse sociotechnique d’une innovation sportive : le cas du kitesurf. Innovations, 43(1), 163-185. https://doi.org/10.3917/inno.043.0163
Boyer, S., Rochat, N., & Rix-Lièvre, G. (2023). Mettre le vécu du sportif au centre de l’accompagnement de la performance. Le journal des psychologies, 405, 39-44.
Burlot, F., & Julla-Marcy, M. (2018). Rythme de vie et accélération du travail sportif : le défi de la performance de haut niveau face à la contrainte du temps. Dans N. Aubert, @ la recherche du temps : Individus hyperconnectés, société accélérée : tensions et transformations (p. 281-293). Érès. https://doi.org/10.3917/eres.auber.2018.01.0281
Burlot, F., Delalandre, M., Joncheray, H., Demeslay, J., Julla-Marcy, M., Heiligenstein, A., & Bignet, F. (2023). Enquête sur les conditions de travail des entraîneurs des jeux olympiques de Tokyo : Des carrières au travail quotidien. Enquête sociologique, rapport qualitatif. INSEP.
Callon, M. (1986). Éléments pour une sociologie de la traduction : La domestication des coquilles Saint-Jacques et des marins-pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc. L’Année Sociologique, 36, 169-208.
Carter, A. (2012). Medicine, Sport and the Body: A Historical Perspective. Bloomsbury. Carter, B., & Dyson, S. M. (2015). Actor Network Theory, agency and racism: The case of sickle cell trait and US athletics. Social Theory & Health, 13(1), 62-77. https://doi.org/10.1057/sth.2014.17
Cinelli, M., De Francisci Morales, G., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W., & Starnini, M. (2021). The echo chamber effect on social media. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(9). https://doi.org/10.1073/pnas.2023301118
Collinet, C. (2006). Une analyse sociologique des savoirs scientifiques comme ressources possibles de l’action d’enseignants d’EPS et d’entraîneurs. STAPS, 71, 115-133.
Dalgalarrondo, S. (2018). Surveiller et guérir le corps optimal Big Data et performance sportive. L’Homme & la Société, 207(2), 99-116. https://doi.org/10.3917/lhs.207.0099
Delalandre, M. (2012). Tensions et coordinations entre les acteurs des sciences de la performance sportive. SociologieS [en ligne]. https://doi.org/10.4000/sociologies.3781
Delalandre, M., Collinet, C., & Terral, P. (2012). Les contraintes de coordination entre scientifiques et entraîneurs dans les structures de transfert de technologies du monde sportif. Socio-logos. Revue de l’Association française de sociologie, 7. https://doi.org/10.4000/socio-logos.2665
Demazière, D., Ohl, F., & Le Noé, O. (2015). La performance sportive comme travail. Sociologie du travail, 57(4), 407-421. https://doi.org/10.4000/sdt.1189
Demeslay, J. (2013). L’institution mondiale du dopage. Sociologie d’un processus d’harmonisation. Pétra. Demeslay, J. (2019). Une approche transversale comme outil de comparaison internationale : L’exemple de l’harmonisation de la lutte antidopage dans le sport. SociologieS [En ligne]. https://doi.org/10.4000/sociologies.12262
Fleuriel, S. (2013). Le sport de haut niveau en France. Sociologie d’une catégorie de pensée. Presses universitaires de Grenoble.
Gibson, K. (2018). Laboratory production of health and performance: an ethnographic investigation of an exercise physiology laboratory. Sport in Society, 22(9), 1604-1622. https://doi.org/10.1080/17430437.2018.1435002
Gould, S. J. (1997). La mal-mesure de l’homme. Odile Jacob.
Heggie, V. (2011). A History of British Sports Medicine. Manchester University Press.
Hoberman, J. (1992). Mortal Engines: The Science of Performance and the De-Humanization of Sport. Free Press.
Hoberman, J. (1995). Sport and the technological image of man. Dans W. J. Morgan & K. V. Meier (dir.), Philosophical enquiry in sport (pp. 202-208). Human Kinetics.
Johnson, A. (2015). “They Sweat for Science”: The Harvard Fatigue Laboratory and Self-Experimentation in American Exercise Physiology. Journal of the History of Biology, 48(3),425-454.
Johnson, A. (2020). Manufacturing Invisibility in “the Field”: Distributed Ethics, Wearable Technologies, and the Case of Exercise Physiology. Dans J. J. Sterling & M. G. McDonald, Sports, Society and Technology: Body, Practices and Knowledge Production (pp. 41-71). Palgrave Macmillan.
Jones, L., Marshall, P., & Denison, J. (2016). Health and well-being implications surrounding the use of wearable GPS devices in professional rugby league: A Foucauldian disciplinary analysis of the normalised use of a common surveillance aid. Performance Enhancement & Health, 5(1), 38-46. https://doi.org/10.1016/j.peh.2016.09.001
Jönsson, K. (2019). Situated knowledges, sports and the sport science question. Sport in Society, 22(9), 1528-1537. Keim, W., & Rodriguez Medina, L. (2023). Routledge Handbook of Academic Knowledge Circulation. Routledge.
Kern, B. D., Bellar, D., & Wilson, W. J. (2023). Examining the knowledge and training of secondary school physical educators providing strength and conditioning programming. Journal of Teaching in Physical Education, 43(1), 102-113. https://doi.org/10.1123/jtpe.2022-0291
Kerr, R. (2016). Sport and Technology. Manchester University Press.
Kuklick, C. R., & Gearity, B. T. (2022). Learning to problematize disciplinary practices: Strength and conditioning coaches’ experiences within a Foucauldian learning community. International Sport Coaching Journal, 10(2), 192-203. https://doi.org/10.1123/iscj.2022-0031
Latour, B. (1989). La science en action. La Découverte.
Le Noé, O., & Trabal, P. (2008). Sportifs et produits dopants : prise, emprise, déprise. Drogues, santé et société, 7(1), 191-236. https://doi.org/10.7202/019623ar
Marcellini, A., Vidal, M., Ferez, S. et De Léséleuc, É. (2010). « La chose la plus rapide sans jambes » Oscar Pistorius ou la mise en spectacle des frontières de l’humain. Politix, 90(2), 139-165. https://doi.org/10.3917/pox.090.0139
Martin-Breteau, N. (2010). « Un laboratoire parfait » ? Sport, race et génétique : le discours sur la différence athlétique aux Etats-Unis. Sciences sociales et sport, 3(1), 7-43. https://doi.org/10.3917/rsss.003.0007
Massengale, J. D., & Swanson, R. A. (1997). The history of exercise and sport science. Human Kinetics.
McDonald, M.G. (2020). Screening saviors?: The Politics of Care, College Sports, and Screening Athletes for Sickle Cell Trait. Dans J. J. Sterling, & M. G. McDonald (dir.), Sports, Society and Technology: Body, Practices and Knowledge Production (pp. 247-267). Palgrave Macmillan.
Mignon, P. (2002). Sociologie du sport professionnel. Les Cahiers de l’INSEP, 42, 35-41.
Mignon, P. (2007). Les deux performances : Ce que les médias ont fait des sportifs. Le Temps des médias, 9(2), 149-163. https://doi.org/10.3917/tdm.009.0149
Miller, P. B. (2004). The anatomy of scientific racism: Racialist responses to Black athletic achievement. Dans P. B. Miller & D. K. Wiggins (dir.), Sport and the Color Line: Black Athletes and Race Relations in Twentieth-Century America (pp. 129-154). Routledge.
Mills, J. P., & Gearity, B. (2016). Toward a sociology of strength and conditioning coaching. Strength and Conditioning Journal, 38(3), 102-105. https://doi.org/10.1519/SSC.0000000000000198
Pape, M. (2019). Expertise and nonbinary bodies: Sex, gender and the case of Dutee Chand. Body & Society, 25(4), 3-28. https://doi.org/10.1177/1357034X19865940
Pape, M. (2020). Ignorance and the Gender Binary: Resisting Complex Epistemologies of Sex and Testosterone. Dans J. J. Sterling, & M. G. McDonald (dir.), Sports, Society and Technology: Body, Practices and Knowledge Production (pp. 219-245). Palgrave Macmillan.
Rix-Lièvre, G., Héros, S., Récopé, M. (2025). S’immerger dans une équipe sportive : étudier l’expérience des joueurs pour transformer leur activité. Éducation permanente, 243, 106-116.
Robertson, C., & Nyaupane, P. (2024). The stadium as sociotechnical change. International Journal of Communication, 18, 793-799.
Robertson, R. E., Jiang, S., Joseph, K., Friedland, L., Lazer, D., & Wilson, C. (2018). Auditing partisan audience bias within Google search. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 2(CSCW). https://doi.org/10.1145/3274417
Roger, A. (2006). Les résistances au changement dans l’entraînement des lanceurs français (1945-1965). STAPS, 71, 37-51.
Sailes, G. (2010). The African American athlete: Social myths and stereotypes. Dans G. Sailes (dir.), Modern Sport and the African American Athlete Experience (pp. 55-68). Cognella.
Scheffler, R. W. (2015). The power of exercise and the exercise of power: The Harvard Fatigue Laboratory, distance running, and the disappearance of work, 1919-1947. Journal of the History of Biology, 48, 391-423. https://doi.org/10.1007/s10739-014-9392-1
Soulé, B., Hallé, J., Vignal, B., Boutroy, É., & Nier, O. (2021). L’innovation dans le sport : Trajectoires d’innovation et optimisation des processus. ISTE.
Star, S. L., & Griesemer, J. (1989), Institutional ecology, ‘Translations’, and Boundary objects: amateurs and professionals on Berkeley’s museum of vertebrate zoology. Social Studies of Science, 19(3), 387-420.
Spracklen, K. (2008). The holy blood and the holy grail: Myths of scientific racism and the pursuit of excellence in sport. Leisure Studies, 27(2), 221-227. https://doi.org/10.1080/02614360801902257
Sterling, J. J. (2022). From Algorithms to AI: Uses and Users of Data in Sport. Society for Social Studies of sport Conference. 7-10 décembre 2022, Cholula.
Svensson, D. (2016). Technologies of Sportification – Practice, Theory and Co-production of Training Knowledge in Cross-country Skiing since the 1950s. European Studies in Sports History, 9, 141-160.
Svensson, D., & Sörlin, S. (2019). The ‘physiologization’ of skiing: The lab as an obligatory passage point for elite sports science. Sport in Society, 22(9), 1574-1588.
Szedlak, C., Callary, B., Eagles, K., & Gearity, B. T. (2024). An exploration of how dominant discourses steer U.K. strength and conditioning coach education. Sport, Education and Society, 29(4), 470-483. https://doi.org/10.1080/13573322.2024.2318650
Terral, P., Collinet, C., & Delalandre, M. (2009). A Sociological Analysis of the Controversy over Electric Stimulation to Increase Muscle Strength in the Field of French Sport Science in the 1990s. International Review for the Sociology of Sport, 44, 399-415.
Thomas, G., Devine, K., & Molnár, G. (2022). Experiences and perceptions of women strength and conditioning coaches: A scoping review. International Sport Coaching Journal, 10(2), 143-155. https://doi.org/10.1123/iscj.2022-0026
Toner, J. (2023). Wearable Technology in Elite Sport: A Critical Examination. Routledge.
Trabal, P., & Zubizarreta Zuzuarregi, E. (2020). A proposal for theoretical and empirical extension of the sociology of anti-doping. Performance Enhancement & Health, 8(2-3), 100177. https://doi.org/10.1016/j.peh.2020.100177
Ventresca, M. (2020). The tangled multiplicities of CTE: Scientific uncertainty and the infrastructure of traumatic brain injury. In J. J. Sterling & M. G. McDonald (dir.), Sports, Society and Technology: Body, Practices and Knowledge Production (pp. 73-98). Palgrave Macmillan.
Wrynn, A. M. (2010). The Athlete in the Making: The Scientific Study of American Athletic Performance, 1920-1932. Sport in History. 30(1), 121-137.
Yang, C., & Cole, C. L. (2020). Smart Stadium as a Laboratory of Innovation: Technology, Sport, and Datafied Normalization of the Fans. Communication & Sport, 10(2), 374-389. https://doi.org/10.1177/2167479520943579