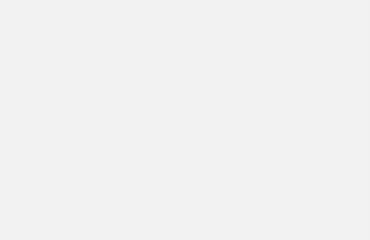Appel à contributions
Argumentaire
Le numéro proposé souhaite éclairer l’utilité et les formes prises par les autobiographies intellectuelles en sciences humaines et sociales ainsi que la manière dont les chercheurs se sont accaparés le genre. Les articles devront questionner la place prise par ces auto-analyses dans la (les) discipline(s) étudiée(s) autant que les conditions sociales et institutionnelles favorisant le développement et/ou les réticences à produire l’ego-histoire. Comment les enseignants-chercheurs1 se sont-ils (ou non) dévoilés et mis en récit, pour quels usages disciplinaires et quelles répercussions sur le métier ? Ces interrogations constituent les deux axes principaux retenus pour ce dossier : 1/ Usages du « parler de soi » et pluralité des formes autobiographiques en sciences humaines et sociales ; 2/ Manières d’écrire sur soi et utilité scientifique des récits de soi.
Ni « autobiographie faussement littéraire, ni confessions inutilement intimes, ni profession de foi abstraite, ni tentative de psychanalyse sauvage » (Nora, 1987 : 7), ni même récits d’enquête, productions réflexives stimulantes déjà largement alimentées en sciences sociales (Paillé, 2006 ; Bizeul, 2007 ; Bouilloud, 2009), les articles ici attendus ont une autre visée. Ce numéro s’intéresse en effet plus précisément aux écrits dans lesquels les enseignants-chercheurs expliquent, à partir de leurs parcours personnel et académique recontextualisés, les raisons les ayant conduits à entrer dans le métier et à y évoluer au travers de disciplines, d’objets, de méthodes ou encore d’approches pouvant ou non varier au cours du temps.
Si les Essais d’ego-histoire, rédigés et rassemblés à l’initiative de Pierre Nora au milieu des années 1980, sont vivement discutés à l’époque (Dosse, 1988 ; Farge, 1988), c’est en ce sens que l’ego-histoire anime, depuis quelques années, la communauté des historiens. La publication en 2015 de la première version de l’ego-histoire rédigée par Georges Duby (2015), l’actualité de la collection Itinéraires fondée par Patrick Boucheron en 2012, les Générations historiennes coordonnées par Yann Potin et Jean-François Sirinelli (2019) témoignent de cette préoccupation du « parler de soi ». Ce mouvement est social et concerne la réflexivité de l’époque sur elle-même. Il est concomitant de l’avènement d’un courant de réflexion méthodologique en sciences humaines et sociales faisant de l’interrogation sur soi une pratique généralisée de la modernité scientifique (Dion et al., 2020). Nul doute en effet qu’il faille dans la démarche accepter que le chercheur fasse partie intégrante de son travail. Il influence celui-ci de manière consciente, mais également inconsciente2, notamment parce que ses socialisations, dispositions et modes de vie agissent comme autant de marqueurs : la recherche, celle qui est « recherche de… » n’existe finalement pas en elle-même, elle est le produit d’une activité humaine, en l’occurrence d’un individu-chercheur impliqué (De la Soudière, 1988).
Le rôle de ces processus et structures cognitives, dans ces écrits, demeure central et permet in fine de mieux comprendre la fabrique du chercheur autant que le chercheur qui fabrique sur ses terrains et dans son laboratoire. Autrement dit, pour reprendre les termes de Pierre Nora, l’objectif de tout ego-histoire est d’« éclairer sa propre histoire comme on ferait l’histoire d’un autre […] d’expliciter, en historien, le lien entre l’histoire qu’on a faite et l’histoire qui vous a fait » (1987 : 7).
L’intérêt pour un tel exercice de réflexivité sur soi n’est pas nouveau. Sans évoquer ici la genèse antique de tels écrits (Ratti, 2006), les XVIIIème et XIXème siècles sont riches en récits de soi d’intellectuels. Et cela malgré les réticences du parler de soi pour une société qui, par pudeur et respect des codes sociaux et religieux notamment, cache l’intime à cette époque (Corbin et al., 2011). Les travaux de Françoise Simonet-Tenant (2021) révèlent ainsi la richesse et la grande diversité de ces écrits. Souvent présentés comme oeuvre à part dans un corpus, ces récits prennent plusieurs formes pour des fonctions différentes. Les récits d’itinéraires exemplaires sont « le fait d’hommes mûrs, qui ont déjà acquis un grand degré de reconnaissance sociale et professionnelle et remplissent avant tout une fonction mémorielle et d’exemplarité ». Les journaux personnels ou correspondances épistolaires constituent, pour l’époque, une autre forme de dévoilement, à l’instar des lettres envoyées par Sigmund Freud à Wilhelm Fliess de 1887 à 1904 et qui participent activement aux réflexions menées par le psychanalyste (Simonet-Tenant, 2021 : 19-20).
Si ces écrits foisonnent, leur signification diffère, d’autant plus que le XXe siècle accélère le processus narratif. Aux autobiographies intellectuelles des siècles précédents qui légitiment, donnent l’exemple et façonnent même l’avancée scientifique, se succèdent au cours du XXe siècle, qui pour les ethnologues et ethnographes le cahier-récit, qui pour les sociologues le récit d’enquête, qui pour les historiens l’ego-histoire, dans une perspective cette fois plus réflexive et méthodologique. Dans le cas particulier de la sociologie, les autobiographies se sont multipliées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, parallèlement au développement de la discipline et sa refondation dans l’après-guerre (Cuin, Gresle, 2002). Depuis, l’élan s’est renforcé et l’éventail des formes adoptées par ces textes est particulièrement large, de l’incise ou du rappel autobiographique dans un ouvrage plus théorique3 jusqu’aux autobiographies classiques4 en passant par l’entretien autobiographique5 (Bouilloud, 2009). En histoire, ce genre ne se développe qu’à partir des années 1980, au moment où se multiplient les publications de mémoires académiques (Jeannelle, 2008). Comme le remarque Antoine Prost, en règle générale, l’historien « évite de s’impliquer dans son texte, de prendre parti, de s’émouvoir » (2014 : 267), ce qui explique en partie ce « retard » et la frilosité des historiens sur le sujet.
La variété des formes prises par le récit de soi en sciences humaines et sociales n’est plus à démontrer : cet appel a essentiellement pour objectif de focaliser le regard sur les écrits intellectuels visant à analyser l’itinéraire du chercheur, sa trajectoire professionnelle (en la rapprochant des origines et propriétés sociales des individus concernés) et les relations qu’il tisse avec son travail, dans la diversité que ce dernier représente. Si aujourd’hui le métier d’enseignant-chercheur a considérablement évolué, le coeur du métier (enseignement et recherche, cf. Charle, 2013 ; Vatin, 2020) demeure. Dans quelle mesure ces « deux invariants historiques » sont-ils pris en compte dans ces écrits, et pourquoi le sont-ils ou ne le sont-ils pas ?
Mais il y a plus. Puisque ce numéro invite à réfléchir à l’individu e(s)t le chercheur, il convient de faire une place au registre des émotions (Paperman, 1995 ; Wacquant, 2011) et même de la personnalité du scientifique (De Sardan, 2000) ou encore de ses engagements sociaux (Heinich, 2002 ; Neveu, 2003 ; Fleury, Walter, 2003) pour « faire société » (Delory-Momberger, 2017 : 14). En quoi l’histoire du chercheur est-elle liée à celle de l’individu et peut-elle éclairer les choix de la discipline, des objets, des méthodes ou encore des approches ? Après tout, « une attention portée sur l’unité du sujet-cherchant – ce qui lui donne sa cohérence – autant que sur sa singularité permet de dépasser la question de l’origine et de la finalité d’un savoir du sujet » (Dheur, 2020 : 233). Parce que, in fine, les qualités humaines des chercheurs, issues en partie de leur parcours de vie, influencent nécessairement leur travail. Les expliciter permet probablement d’offrir une meilleure compréhension de la part de subjectivité intrinsèque à toute recherche (Naudier, Simonet, 2011).
Axes thématiques
Les articles, inédits, pourront s’inscrire dans les axes de recherche suivants :
Axe 1 : Usages du « parler de soi » et pluralité des formes autobiographiques en sciences humaines et sociales
Aujourd’hui, historiens, géographes, psychologues, politologues, ethnologues s’engagent – avec plus ou moins de prudence néanmoins – dans ces écritures donnant à lire le lien étroit entretenu par le chercheur avec ses objets et ses démarches dans des contextes de travail extrêmement diversifiés (local, national, disciplinaire, professionnel, etc.) ; jusqu’à questionner l’évolution des positionnements théoriques et méthodologiques et l’écriture scientifique du récit de soi (Bronner, 2024). Nul doute néanmoins que les formes prises par ces écrits demeurent variées et portent des valeurs épistémologiques différentes. Dans les écrits autobiographiques historiens, ce qui l’emporte est davantage la mise en scène de soi qu’une analyse en profondeur, et cette présentation de soi renvoie à l’image qu’historiens et historiennes se font de leur métier (Lacoue-Labarthe, 2023).
Ainsi, l’exercice qui consiste, comme l’écrit Jean-Pierre Olivier de Sardan à « faire feu de tout bois » (2008 : 52), à multiplier les sources et angles de recherche, à valoriser même cette diversité comme un élément structurant de l’activité du chercheur, semble aujourd’hui plus largement accepté et varié en sciences humaines et sociales. Si l’ouverture d’esprit et l’élargissement du spectre d’observation et d’analyse constituent désormais une règle académique de la recherche, il arrive parfois que le chercheur soit confronté à lui-même dans son travail. Autrement dit, et pour paraphraser la sociologue Muriel Darmon, qu’il soit lui-même « un objet de plein droit […] voire un véritable matériau d’analyse [en] lui-même » (2005 : 99). La question est ici de savoir sous quelles formes cette approche réflexive se décline à l’écrit dans les disciplines que composent les sciences humaines et sociales et pour quel intérêt heuristique. L’ambition est, in fine, d’identifier ici des points communs et des singularités disciplinaires.
Axe 2 : Manières d’écrire sur soi et utilité scientifique des récits de soi
Si la question des effets d’enquête fait l’objet d’un renouveau scientifique ces dernières années et interroge, en sociologie pour exemple6, la place, la position et la neutralité du chercheur face à ses objets, il va de soi que ce dernier contamine autant qu’il stimule le travail scientifique. La trajectoire, le parcours professionnel, les expériences de vie, la personnalité, les émotions ressenties, le sens attribué aux situations vécues, qu’il le veuille ou non, ne sont pas neutres. Après tout, « l’illusion biographique » (Bourdieu, 1986) ne déligitime en rien l’approche (auto)biographique ici esquissée : le problème central, en sciences humaines et sociales, n’est pas tant dans l’utilisation d’une telle approche ni dans les matériaux choisis que dans la manière de les analyser (Heinich, 2010). Surtout lorsqu’il s’agit de se raconter. Si l’autobiographie constitue « le récit rétrospectif qu’une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie intellectuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalité », cette dernière « gêne intellectuellement, esthétiquement, affectivement : c’est là ce qu’elle a de meilleur » (Lejeune, 2010 : 14).
Finalement, il s’agit désormais, d’inscrire le travail dans une « réflexivité méthodologique plus large que procure le métier » (Bourdieu, Wacquant, 2014 : 122) et dans un questionnement qui interroge l’identité socio-professionnelle de l’enseignant-chercheur au sein de sa communauté. Centrale pour les anthropologues, la question des rapports qu’entretient le savant avec sa discipline, son objet, son terrain voire ses enquêtés a aujourd’hui définitivement pénétré l’ensemble des sciences humaines et sociales.
Indéniablement, ces traces écrites de soi renseignent les manières de faire le métier d’enseignant-chercheur. À l’instar des « carrières d’ethnographes, des manières de s’engager » (Monjaret, 2019 : 11), il s’agit tout particulièrement d’explorer l’engagement et la diversité du labeur propre à une profession et une discipline. L’enseignant-chercheur, par son itinéraire et sa trajectoire sociale et professionnelle, entretient une relation forte avec son activité : que ce soit dans le choix des objets, du rythme de travail, de la manière de produire de la connaissance et de la mettre en récit, mais également dans les démarches choisies et les conditions de la recherche. C’est ici que les productions devraient permettre d’éclairer autrement, en faisant jouer le présent et le passé, les évolutions les plus contemporaines du métier d’enseignant-chercheur en sciences humaines et sociales (Annoot, 2011), sans oublier de stimuler l’effet mémoriel utile aux jeunes apprentis.
Modalités de soumission
Les propositions d’articles sont à envoyer au plus tard le 23 MAI 2025 aux deux coordonnateurs du numéro : Jean Bréhon (jean.brehon@univ-artois.fr) et Noémie Beltramo (noemie.beltramo@univ-artois.fr) sous la forme d’un résumé de 1000 mots accompagné de 4 à 6 mots-clés, et en indiquant l’axe retenu.
Les auteurs pressentis seront contactés le lundi 10 juin 2025.
Les articles (40 000 signes maximum, espaces compris) rédigés selon les indications présentées sur le site de la revue Émulations, revue de sciences sociales seront transmis le lundi 15 septembre 2025 au plus tard par mail aux coordinateurs du numéro. Ils seront évalués par deux évaluateurs extérieurs (peer review).
Calendrier prévisionnel du numéro
23 mai 2025 : date limite d’envoi des propositions d’articles (sous la forme d’un résumé de 1000 mots maximum)
10 juin 2025 : communication des décisions aux auteur·e·s
15 septembre 2025 : date limite d’envoi de la première version des manuscrits (40 000 signes espaces compris, aux normes de mise en page de la revue)
30 novembre 2025 : transmission des évaluations 1 aux auteur·e·s
30 janvier 2026 : date limite d’envoi de la deuxième version des manuscrits par les auteur·e·s
15 mars 2026 : transmission des deuxièmes évaluations aux auteur·e·s
15 avril 2026 : réception de la troisième version des manuscrits par les auteur·e·s
Eté 2026 : publication du numéro papier et mise en ligne
Bibliographie indicative
ANNOOT E. (2011), « Le métier d’enseignant chercheur », in E. Imelda (dir.), Mutations de l’enseignement supérieur et internationalisation. Change in Higher Education and Globalisation, Paris, De Boeck Supérieur (« Pédagogies en développement »), p. 221-231.
BIZEUL D. (2007), « Que faire des expériences d’enquête ? Apports et fragilité de l’observation directe », Revue française de science politique, n°57, p. 69-89.
BOUILLOUD J.-P. (2009), Devenir sociologue. Histoires de vie et choix théoriques, Toulouse, Érès.
BOURDIEU P. (1986), « L’illusion biographique », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 62-63, p. 69-72.
BOURDIEU P., WACQUANT L. (2014), Invitation à la sociologie réflexive, Paris, Seuil (« Liber »).
BRONNER G. (2024), Exorcisme, Paris, Grasset.
CHARLE C. (2013), Homo Historicus. Réflexions sur l’histoire, les historiens et les sciences sociales, Paris, Armand Colin (« Le temps des idées »).
CORBIN A., COURTINE J.-J., VIGARELLO G. (dir.) (2011), Histoire de la virilité. Volume II, Le triomphe de la virilité. Le XIXe siècle, Paris, Le Seuil.
CUIN C.-H. et GRESLE F. (2002), Histoire de la sociologie. Tome 2. Depuis 1918, Paris, La Découverte (« Repères »).
DARMON M. (2005), « Le psychiatre, la sociologue et la boulangère : analyse d’un refus de terrain », Genèses, n°58, p. 98-112.
DE LA SOUDIERE M. (1988), « L’inconfort du terrain », Terrain, n° 11, p. 94-105.
DELORY-MOMBERGER C. (2017), « De quel savoir la recherche biographique en éducation est-elle le nom ? », Actuels, n° 6, p. 9-22.
DHEUR S. (2020), « Médialités biographiques de la pratique scientifique », Actuels, n° 9, p. 233-243.
DION É., KUSHTANINA V., LAGIER E., PAPE É., PERRIN-JOLY C. (dir.) (2020), Parler de soi. Méthodes biographiques en sciences sociales, Paris, EHESS (« En temps et lieux »).
DOSSE F. (1988), « Une égoïstoire ? », Le Débat, n° 49, p. 122-124.
DUBY G. (2015), Mes ego-histoires, Paris, Gallimard (« Blanche »).
FARGE A. (1988), « L’histoire inquiète », Le Débat, n° 49, p. 125-126.
FLEURY-VILATTE B. et WALTER J. (2002), « L’engagement des chercheurs », Questions de communication, n° 2, p. 105-115.
HEINICH N. (2002), « Pour une neutralité engagée », Questions de communication, n° 2, p. 117-127.
HEINICH N. (2010), « Pour en finir avec l’“illusion biographique” », L’Homme, n° 195-196, p. 421-430.
JEANNELLE J.-L. (2008), Écrire ses Mémoires au XXe siècle. Déclin et renouveau, Paris, Gallimard (« Bibliothèque des Idées »).
LACOUE-LABARTHE I. (2023), « Ego historicus. Quand historiens et historiennes se racontent. France, XXe-XXIe siècles », Revue d’histoire culturelle, [En ligne], 6.
LEJEUNE P. (2010), L’autobiographie en France, Paris, Armand Colin (« Cursus »).
MONJARET A. (dir.) (2019), Carrières, Paris, Presses universitaires de Paris Nanterre (« Ethnographies plurielles »).
NAUDIER D. et SIMONET M. (dir.) (2011), Des sociologues sans qualités ? Pratiques de recherche et engagements, Paris, La Découverte (« Recherches »).
NEVEU É. (2003), « Recherche et engagement : actualité d’une discussion », Questions de communication, n° 3, p. 109-120.
NORA P. (1987), Essais d’ego-histoire, Paris, Gallimard (« Bibliothèque des Histoires »).
OLIVIER DE SARDAN J.-P. (2008), La rigueur du qualitatif. Les contraintes empiriques de l’interprétation socio-anthropologique, Louvain-La-Neuve, Academia-Bruylant.
PAPERMAN P (1995), « La question des émotions : du physique au social », L’Homme et la société, n° 116, p. 7-17.
PAILLE P. (dir.) (2006), La méthodologie qualitative. Postures de recherche et travail de terrain, Paris, Armand Colin (« Collection U »).
POTIN Y., SIRINELLI J.-F. (dir.) (2019), Générations historiennes, Paris, Éditions CNRS.
PROST A. (2014), Douze leçons sur l’histoire, Paris, Seuil (« Points Histoire »).
RATTI S. (2006), « Les racines antiques du genre biographique », L’information littéraire, vol. 58, p. 3-11.
SIMONET-TENANT F. (2021), « La narration professionnelle de soi chez les intellectuelles. Intérêt porté à l’exercice par les historiens, réticence des chercheurs en littérature », in A. PIPONNIER, C. SEGUR (dir.), Identités du chercheur et narrations en sciences humaines et sociales, Nancy, Éditions universitaires de Lorraine (« Questions de communication, série actes »), p. 17-33.
VATIN F. (2020), « Enseignant/chercheur : un métier ou deux ? », Revue française de pédagogie, vol. 207, p. 87-94.
WACQUANT L. (2011), « La chair et le texte : l’ethnographie comme instrument de rupture et de construction », in D. NAUDIER, M. SIMONET (dir.), Des sociologues sans qualités ? Pratiques de recherche et engagements, Paris, La Découverte (« Recherches »), p. 201-221.
- Dans cet écrit, nous utilisons exclusivement le genre masculin. Ce raccourci, certes réducteur, est ici utilisé dans un souci de lisibilité bien qu’il fasse l’économie des apports de la sociologie du genre et des rapports sociaux de sexe, auxquels nous souscrivons. Cette remarque est d’importance eu égard à la sociologie du groupe professionnel concerné, au projet porté par ce numéro et aux propositions qui pourront être orientées précisément sur ce point. ↩︎
- En guise d’illustration, consulter : THEBAUD F. (2009), « Entre parcours intellectuel et essai d’ego-histoire. Le poids du genre », Genre & Histoire [en ligne], n° 4. ↩︎
- Pour exemples, BALANDIER G. (1977), Histoire d’autres, Paris, Stock (« Les grands auteurs »). LEVI-STRAUSS C., ERIBON D. (1988), De près et de loin, Paris, Odile Jacob. LAURENT J.-P. (2004), « Pierre Bourdieu par Pierre Bourdieu, ou la question du double », Critique, vol. 689, p. 776-790. ↩︎
- Pour exemples, MORIN E. (1959), Autocritique, Paris, Seuil. TOURAINE A. (1977), Un désir d’Histoire, Paris, Stock (« Les grands auteurs »). MENDRAS H. (1995), « La société change et l’observateur aussi », Le Débat, vol. 83, p. 113-123. ↩︎
- Pour exemple, BOUDON R. (2013), « Ma traversée dans le monde scientifique (I) », Commentaire, vol. 142, p. 343-348. ↩︎
- On citera ici et pour exemple, BIZEUL D. (1998), « Le récit des conditions d’enquête : exploiter l’information en connaissance de cause », Revue française de sociologie, n° 39, p. 751-787. Ou encore, dans le domaine de la sociologie du sport, HIDRI NEYS O. (dir.) (2022), « Le récit d’enquête (1/2) : les gains de la réflexivité en sciences sociales du sport », Society and Leisure, vol. 45. HIDRI NEYS O. (dir.) (2024), « Le récit d’enquête (2/2) : les dessous des enquêtes de terrain en sciences sociales du sport », Society and Leisure, vol. 47. ↩︎