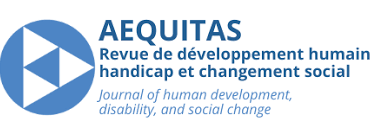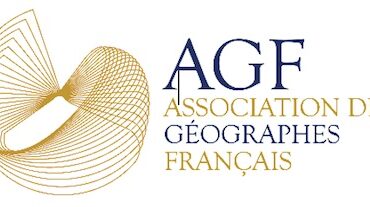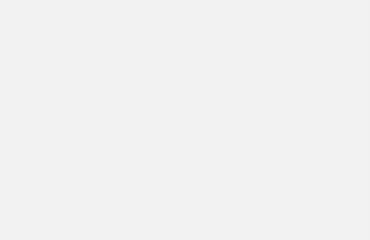LE SPORT, UNE RELIGION MODERNE ? LES RELIGIONS ET LE SPORT
18-20 novembre 2026 à Angers
Appel à communications
Dans son ouvrage posthume majeur, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien (1949), Marc Bloch soulignait que « l’histoire est une science qui a besoin de temps : le temps de la recherche, le temps de la réflexion, le temps de l’écriture ». Cette observation résonne particulièrement à notre époque, où la pression exercée sur les chercheurs pour rendre compte de leurs travaux est omniprésente, comme en témoignent les appels à communication pour des colloques scientifiques, souvent diffusés quelques semaines seulement avant l’événement.
Conscients de cette contrainte et soucieux de répondre aux besoins exprimés par nos collègues, nous avons fait le choix, pour l’organisation des 22èmes Carrefours d’histoire du sport, de prendre le contre-pied de cette tendance. Afin de favoriser une réflexion et une recherche approfondies, cet appel à communication est diffusé plus d’un an et demi avant la tenue de l’événement. Nous souhaitons ainsi offrir aux enseignants-chercheurs, doctorants et étudiants le temps nécessaire pour mener à bien leurs travaux et contribuer de manière significative à nos échanges.
Projet scientifique
« La première caractéristique essentielle de l’olympisme ancien aussi bien que de l’olympisme moderne, c’est d’être une religion. En ciselant son corps par l’exercice comme le fait un sculpteur d’une statue, l’athlète antique “honorait les dieux”. En faisant de même, l’athlète moderne exalte sa patrie, sa race, son drapeau. J’estime donc avoir eu raison de restaurer dès le principe, autour de l’olympisme rénové, un sentiment religieux transformé et agrandi par l’Internationalisme et la Démocratie qui distinguent les temps actuels, mais le même pourtant qui conduisait les jeunes Hellènes ambitieux du triomphe de leurs muscles au pied des autels de Zeus1 ».
En rénovant les Jeux olympiques tout en créant le concept d’olympisme, Pierre de Coubertin envisage le sport comme une religion moderne à travers l’exaltation de valeurs, la création de communautés, le culte des héros et des mises en scène spectaculaires. Il promeut la défense de valeurs morales et religieuses fondées sur l’élitisme et l’humanisme, tout en tissant un lien entre les Jeux olympiques modernes et les multiples jeux antiques (jeux d’Olympie, jeux pythiques, jeux de Némée, jeux isthmiques, jeux d’Athènes), dont les pratiques étaient alors intégrées à la vie religieuse hellénique.
L’héritage de cette vision sacralisée du sport imprègne les sociétés modernes. Dans son ouvrage de référence sur la nature des sports modernes, Allen Guttmann affirme que si que le sport s’est progressivement sécularisé, rompant avec des origines religieuses pour devenir une activité autonome, bureaucratisée et rationalisée, il conserve aussi certains traits empruntés aux pratiques religieuses (passion, rituels, mythes…)2.
Cette double-dynamique, entre sécularisation et persistance de traits religieux, invite à interroger plus largement le rapport entre sport(s) et religion(s). D’un côté, le sport véritable « religion moderne », offre en lui-même un cadre symbolique et des rituels qui structurent la vie collective. D’un autre côté, les différentes religions établies n’ont cessé de dialoguer, d’adopter ou de résister aux valeurs sportives, donnant lieu à des débats et prises de position parfois passionnés. L’actualité récente met en évidence ces enjeux. Le colloque organisé par le Vatican en mai 2024 sur la « synodalité sportive » avant les Jeux olympiques de Paris3, ou encore les débats autour de la place des symboles religieux dans les événements sportifs4, soulignent la nécessité d’approfondir et d’historiciser ces questions.
Ce colloque vise à explorer la richesse des interactions entre sport et religion, à travers deux axes de réflexion.
Axe 1 : Le sport, une religion moderne
Ce premier axe interroge les parallèles et les continuités entre le sport et la religion en tant que phénomènes sociaux et culturels. Le sport est en effet souvent assimilé à une nouvelle religion ou à une « religion laïque » dans un monde contemporain marqué à la fois par le déclin des pratiques religieuses dans certains pays (en Europe notamment) et par des conflits religieux majeurs. L’analogie entre l’olympisme, le sport et la religion a, certes, déjà fait l’objet de multiples publications5, mais les recherches récentes montrent toute la vitalité de cette thématique et l’intérêt de poursuivre ces travaux6.
Les contributions s’attacheront à explorer les thèmes suivants :
• Le sport, une religion du progrès : Comment Pierre de Coubertin et d’autres penseurs ont-ils conçu le sport comme un vecteur de transformation sociale, éthique et morale ?
• Le sport, espace de lien social : les événements sportifs peuvent-ils être analysés comme des rituels communautaires, créant à la fois de la communion et du communautarisme ?
• Les héros sportifs et les spectacles sportifs : Quelles sont les similitudes entre le culte des héros sportifs modernes et les figures divines des religions ? Comment les grands spectacles sportifs structurent-ils des célébrations collectives ?
• Rôle des médias : Comment les médias ont-ils participé à la construction d’une religion du sport ?
• Un nouvel opium du peuple ? Dans quelle mesure les thèses critiques, comme celles de Jean-Marie Brohm, permettent-elles d’analyser le sport comme un dispositif de contrôle social et d’évasion ?
Axe 2 : Les religions et le sport
Ce second axe s’intéresse aux relations que les religions ont entretenu avec le sport depuis la fin du XIXème siècle. Si le sport est souvent perçu comme laïque, son émergence a été influencée par des modèles éducatifs et des valeurs propres à certaines traditions religieuses. Cette thématique était, en partie, l’objet des 10èmes Carrefours d’Histoire du sport qui ont eu lieu à l’ILEPS de Cergy-Pontoise en novembre 2002 sous le titre « Sports, éducation physique et mouvements affinitaires au XXème siècle » ; et la publication des actes a permis d’approfondir les connaissances sur les mouvements protestants ou catholiques7. D’autres travaux ont été menés sur les mouvements sportifs chrétiens et juifs8, tandis que les études manquent sur les relations entre le sport et l’Islam, l’Hindouisme ou le Bouddhisme.
Les 22èmes Carrefours d’histoire du sport ont pour ambition d’approfondir ces recherches et les communications pourront porter sur les thèmes suivants :
• Modèles éducatifs et valeurs religieuses : Comment les différentes confessions (catholique, protestante, juive, musulmane, hindoue, etc.) ont-elles adopté ou adapté les pratiques sportives pour transmettre leurs propres valeurs ?
• Manifestations religieuses dans l’arène sportive : Quelle est la place des symboles, rituels ou pratiques religieuses dans les événements sportifs internationaux ?
• Champions sportifs et religion : En quoi la religion influence-t-elle les carrières et les pratiques des sportifs de haut niveau ? Quels rôles jouent les rituels personnels et collectifs ?
• Conflits religieux dans le sport : Comment les tensions entre différentes confessions s’expriment-elles dans les pratiques sportives ? Quels sont les enjeux géopolitiques et culturels associés ?
• Femmes, religions et pratiques sportives : Quelles contraintes ou opportunités les traditions religieuses offrent-elles aux sportives dans différents contextes ?
Propositions de communications
Les propositions de communication (500 mots environ) doivent être envoyées par courrier électronique aux organisateurs avant le 30 avril 2026. Les résumés doivent préciser l’axe retenu, les sources utilisées, la problématique et les principaux résultats. Les références bibliographiques seront limitées à cinq et placées en notes de bas de page. Une présentation succincte de l’auteur·rice doit apparaitre en amont du résumé.
Étienne Pénard (epenard@uco.fr) et Doriane Gomet (dgomet@uco.fr)
APCoSS UCO-IFEPSA
49 Rue des Perrins, 49130 Les Ponts-de-Cé, France
Conditions d’accueil
Les Carrefours d’histoire du sport se tiendront à l’UCO-IFEPSA à Angers – Les-Ponts-de-Cé. L’Institut est accessible en transports en commun (gare d’Angers, bus). Les communications auront lieu dans les amphithéâtres de l’institut.
Sous réserve de l’acceptation des participant·e·s, les journées seront filmées. Les vidéos seront disponibles sur le site de l’IFEPSA.
Valorisation scientifique
Ce colloque donnera lieu à une publication scientifique à paraître soit dans une revue francophone soit sous forme d’ouvrage collectif.
Comité d’organisation
Christophe Angot, Maître de conférences, UCO-IFEPSA
Doriane Gomet, Maîtresse de conférences, UCO-IFEPSA, Université de Rennes 2
Bénédicte Noury, Professeure des universités, UCO-IFEPSA
Étienne Pénard, Maître de conférences, UCO-IFEPSA, Université de Rennes 2
Arnaud Sébileau, Maître de conférences-HDR, UCO-IFEPSA
Comité scientifique
Michaël Attali, Professeur des universités, Université de Rennes 2
Thomas Bauer, Professeur des universités, Université de Limoges
Natalia Bazoge, Maîtresse de conférences, Université Grenoble Alpes
Lise Cardin, Maîtresse de conférences, Université de Strasbourg
Olivier Chovaux, Professeur des universités, Université d’Artois
Yohann Fortune, Maître de conférences HDR, Université de Rennes 2
Doriane Gomet, Maîtresse de conférences, UCO-IFEPSA
Laurence Munoz, Maîtresse de conférences, Université du littoral Côte d’Opale
Lionel Pabion, Maître de conférences, Université de Rennes 2
Étienne Pénard, Maître de conférences, UCO-IFEPSA
Jean-Nicolas Renaud, Maître de conférences-HDR, ENS Rennes
Jean Saint-Martin, Professeur des universités, Université de Strasbourg
- Pierre de Coubertin, Les Assises philosophique de l’Olympisme moderne, Message radiodiffusé de Berlin le 4 août 1935. ↩︎
- Allen Guttmann, Du rituel au record : la nature des sports modernes, Thierry Terret (trad.), [1ère éd. : 1978], Paris, L’Harmattan, 2006. ↩︎
- https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2024-05/un-exercice-de-synodalite-sportive-un-colloque-l-eglise-sport.html ↩︎
- Le gouvernement français a par exemple publié en mai 2019 un guide Laïcité et fait religieux dans le champ du sport : mieux vivre ensemble . ↩︎
- Jean Saint-Martin, « La naissance du sport ou le ramasse-mythes des temps modernes (1888-2000) », dans Michaël Attali, Le sport et ses valeurs, Paris, La Dispute, 2004, p. 19-65. ↩︎
- Jean-Marie Brohm, « La religion athlétique de Coubertin, admirateur de l’olympisme nazi », Pouvoirs, vol. 189, no 2, 2024, p. 61-71 ; Paul Dietschy (dir.), « Les religions du football », numéro spécial de la revue Football(s), Histoire, culture, économie, société, 2024. ↩︎
- Laurence Munoz, « La fédération des patronages : lien institutionnel entre le sport et le catholicisme en France (1898-2000) », dans Pierre-Alban Lebecq, Sport, éducation physique et mouvements affinitaires au XXe siècle. Tome 2 : valeurs affinitaires et sociabilité, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 49-61 ; Thierry Terret, « Le rôle des Young Men’s Christian Associations (YMCA) dans la diffusion du sport en France pendant la Première Guerre mondiale », dans Pierre-Alban Lebecq, Sport, éducation physique et mouvements affinitaires au XXe siècle. Tome 1 : Les pratiques affinitaires, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 27-56. ↩︎
- Danielle Delmaire, « Les mouvements de jeunesse juifs en France, 1919-1939 », dans Gérard Cholvy, Mouvements de jeunesse chrétiens et juifs : sociabilité juvénile dans un cadre européen, 1799-1968, Paris, Cerf, 1985, p. 313-330 ; Étienne Pénard, Doriane Gomet et Michaël Attali, « Les activités physiques et sportives dans les institutions juives françaises durant l’Entre-deux-guerres (1918–1939) : un éclectisme de pratiques et d’objectifs », Sport History Review, vol. 52, no 1, 2021, p. 90-108. ↩︎